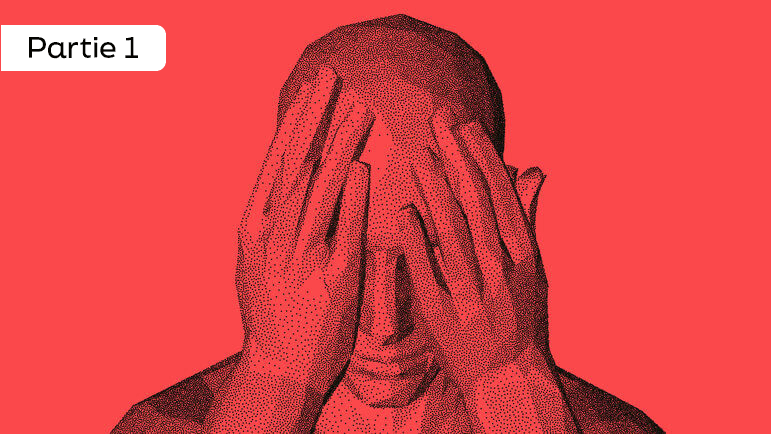
L’incontinence anale, un trouble honteux pour les malades et souvent ignoré des médecins.StudioM1 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
L'incontinence anale se définit comme l'incapacité à contrôler l'émission de gaz ou de matières fécales. Elle peut être passive (fuite sans perception), active (urgence avec impossibilité de se retenir) ou mixte. Sa prévalence est estimée entre 5 à 10 % dans la population générale. Mais, considérée comme honteuse par les patients, cette pathologie reste largement sous-diagnostiquée.
Le premier bilan de l'incontinence anale est réalisé le plus souvent par le médecin généraliste. Celui-ci repose principalement sur l'interrogatoire et l'examen clinique.
La prise en charge initiale par des méthodes conservatrices permet une amélioration significative dans 60 à 80 % cas. Cette approche non invasive repose sur une régularisation du transit et une rééducation anopérinéale par biofeedback.
Quand adresser au spécialiste ?
En cas d’échec des mesures de première ligne, de signes d'alerte (douleurs, saignements...), ou de troubles importants de la statique pelvienne, un avis spécialisé est demandé. Le bilan peut alors être complété par un ou plusieurs des examens complémentaires suivants : manométrie anorectale, échographie endo-anale, colpocystodéfécographie ou déféco-IRM. La stimulation tibiale postérieure par TENS et/ou l’irrigation transanale (système Peristeen) sont des traitements non invasifs de seconde ligne que les patients peuvent utiliser en toute autonomie.
La prise en charge des formes sévères d'incontinence anale en échec des traitements non invasifs a été traitée dans une seconde partie.
L'incontinence anale (IA) se définit comme l'incapacité à contrôler l'émission de gaz ou de matières fécales, qu'elles soient liquides ou solides [1].
Elle peut être :
- passive : fuite sans perception préalable ;
- active : par urgence avec impossibilité de se retenir en dépit d’une sensation de besoin ;
- mixte : passive et active.
Sa sévérité est évaluée par des scores cliniques comme celui de Jorge et Wexner (ou score de Cleveland) qui prend en compte la fréquence des épisodes, leur nature, l'impact sur la qualité de vie et l’utilisation de protections. Au-delà de la physiopathologie, c’est souvent l’impact psychologique et social qui rend l’IA invalidante.
Une pathologie sous-déclarée et mal dépistée
Il est difficile de chiffrer précisément la prévalence de l’IA qui est un trouble sous-diagnostiqué. On l’évalue entre 5 à 10 % dans la population générale, avec une nette augmentation chez les femmes de plus de 50 ans (jusqu’à 25 % selon certaines études), les patients en institution (près de 50 %) et les sujets souffrant de maladies neurologiques ou digestives chroniques [2]. Dans une étude menée en Rhône-Alpes en 2006, 85 % des médecins interrogés ignoraient l'existence d'une IA chez leurs patients [2].
Quels facteurs de risque ?
Parmi les principaux facteurs de risque d’IA [1], on note :
- les traumatismes obstétricaux : rupture sphinctérienne (30 % des primipares peuvent présenter une lésion sphinctérienne occulte), neuropathie d’étirement, désinsertion des releveurs de l’anus ;
- une chirurgie anorectale : fistule (cf. Photos), hémorroïdes, résection antérieure du rectum ;
- une chirurgie gynécologique : troubles de la statique pelvienne ;
- l’âge (vieillissement musculaire et neurologique) ;
- des pathologies neurologiques : AVC, sclérose en plaques, neuropathie pudendale ;
- des maladies générales (diabète, sclérodermie) ;
- une maladie inflammatoire chronique de l’intestin ;
- des séquelles de la radiothérapie (entérite radique) ;
- une constipation distale avec efforts de poussée excessifs (neuropathie d’étirement) ;
- une pratique sportive intensive (running, haltérophilie, etc.) [3].
Quelles causes ?
On distingue plusieurs mécanismes d’IA qui sont souvent intriqués [4] :
- atteinte sphinctérienne :
- sphincter anal interne,
- sphincter anal externe,
- les deux sphincters ;
- atteinte du réservoir rectal : compliance rectale altérée, mégarectum ;
- neurologique : neuropathie périphérique ou centrale ;
- sensoriel : trouble de la perception rectale ;
- anatomique : prolapsus rectal, rectocèle, périnée descendant ;
- fonctionnel : coordination musculaire perturbée (dyssynergie).
Une IA active oriente vers une atteinte du sphincter externe ou du réservoir rectal, et une IA passive vers une atteinte du sphincter interne ou un trouble de la sensibilité rectale.
Interrogatoire et examen clinique : points clés
Le recueil précis des antécédents, de la symptomatologie et des traitements en cours représente la pierre angulaire de la prise en charge de l’IA. Ces différents renseignements permettent d’évaluer la réalité de l’IA et d’écarter les diagnostics différentiels tels qu’une fausse diarrhée liée à une constipation, un usage excessif de laxatifs, des troubles fonctionnels intestinaux à prédominance diarrhéique, ou encore des suintements fécaux ; ces derniers pouvant être dus par exemple à une pathologie hémorroïdaire prolabée, une dermite, une fistule anale ou un fécalome (fréquent notamment chez les personnes âgées institutionnalisées).
L’interrogatoire permet de quantifier l’incontinence, d’en supposer le mécanisme et d’évaluer son impact sur la qualité de vie du patient. Il doit au minimum recueillir les informations suivantes [4] :
- fréquence et type de fuites (gaz, liquides, solides) ;
- existence d’une impériosité ou d’un suintement passif ;
- contexte : postobstétrical, chirurgical, affection neurologique, etc. ;
- qualité de vie.
L’examen clinique en genu pectoral ou en décubitus latéral gauche comporte [4] :
- l’inspection de la marge anale à la recherche de lésions visibles avec notamment des déformations postchirurgicales ou postobstétricales ; une souillure spontanée de la marge anale (synonyme d’une IA sévère) ;
- l’inspection du périnée à la recherche de troubles de la statique pelvienne et en particulier d’un prolapsus total du rectum ;
- le toucher anal et rectal au repos et à l’effort qui évalue :
- le tonus de repos,
- la contraction volontaire,
- la détente à la poussée,
- la présence de matières dans l’ampoule rectale, d’un fécalome ;
- l’examen neurologique qui vérifie la sensibilité périnéale et la perception rectale (présence ou non d'un fécalome).
Quel bilan de première intention ?
Le bilan initial repose essentiellement sur l’interrogatoire et l’examen clinique. Une exploration biologique n’est pas systématique et est prescrite selon le contexte (antécédents personnels, type d’IA, signes associés, etc.) :
- NFS, CRP, TSH ;
- examen coproparasitologique des selles ;
- dosage de la calprotectine fécale.
Une coloscopie est raisonnablement proposée chez toute personne de plus de 50
Quelle prise en charge en médecine générale ?
La régularisation du transit et l’amélioration de la consistance des selles constituent une priorité dans la prise en charge des patients.Il n’y a pas d’alimentation type qui conviendrait à tous. Le régime doit être personnalisé afin d’obtenir des selles bien formées (types 3 et 4 sur l’échelle de Bristol), de stabiliser le transit et réduire les épisodes d’urgences défécatoires. Il est conseillé au patient de tenir un calendrier des selles qui permettra d’adapter finement les traitements et d’objectiver les progrès [4].
Conseils hygiéno-diététiques et régulateurs du transit : la priorité
Concernant l’alimentation, l’apport en fibres doit être adapté, notamment en fibres solubles si les selles sont liquides (de type psyllium, graines de lin, graines de chia, fibres d’acacia, etc.). Il faut éviter les fibres insolubles (blé, légumes crus), car elles peuvent majorer les symptômes chez certains patients (cf. notre article du 23 octobre 2024). Il en est de même pour les irritants digestifs (café, alcool, tabac, épices). Une activité physique quotidienne, une régularité du rythme intestinal et une hydratation suffisante sont également recommandées.
Parmi les traitements régulateurs du transit :
- le lopéramide (petites doses titrées) permet de réduire le nombre de selles en particulier chez des patients souffrant d’un syndrome de l’intestin irritable avec diarrhée prédominante et selles liquides ;
- les mucilages (molécules cellulopectosiques d'origine biologique), dont les principaux sont extraits de graines (psyllium, ispaghul). Ils améliorent la consistance des selles (bien moulées ni trop liquides ni trop dures) (cf. VIDAL RECO « constipation de l’adulte ») ;
- les suppositoires ou lavements évacuateurs par voie rectale (cf. VIDAL RECO « constipation de l’adulte ») permettent de vider l’ampoule rectale en cas de troubles de l’évacuation avec IA par regorgement sur rectum plein.
Quelle place pour la rééducation anopérinéale ?
La rééducation anopérinéale est une approche de première ligne à mettre en œuvre avant la réalisation d’éventuels examens complémentaires.
La rééducation par biofeedback est la plus efficace et la seule validée dans les dernières recommandations françaises qui viennent de paraître [5].
Elle est d’autant plus efficace que l’incontinence est récente et le patient motivé. Inversement, des troubles de la statique pelvienne majeurs, une dénervation périnéale, un manque de motivation ou un syndrome dépressif sont associés à un taux d'échec plus élevé.
Il faut compter au moins 10 séances et le nombre moyen de séances est de 10 à 20. Cette rééducation doit être réalisée par des kinésithérapeutes spécialisés (cf. le site de l’Association française de rééducation en pelvipérinéologie pour prescrire une rééducation pelvi-périnéale et accéder à l'annuaire). Une manométrie préalable (cf. paragraphe « La manométrie anorectale » ci-dessous) permet dans certains cas de guider les objectifs de la rééducation.
Cette rééducation comporte :
- des exercices de renforcement musculaire ;
- un travail en biofeedback (rétrocontrôle visuel) ;
- une électrostimulation périnéale ;
- un travail abdomino-périnéal global ;
- des exercices au ballonnet rectal pour améliorer la sensibilité rectale.
Quand orienter vers un spécialiste gastro-entérologue/proctologue ?
La majorité des patients (61 %) sont significativement améliorés par une régularisation du transit (même en présence d’un défect sphinctérien significatif) [6].
En présence de causes nécessitant un traitement spécifique (MICI, affection neurologique, prolapsus total du rectum…) et/ou de signes d’appel avec doute sur une pathologie organique (douleurs, saignements), l’avis d’un spécialiste est nécessaire.
Il en est de même en cas d’échec des mesures conservatrices de première ligne.
Le bilan pourra être complété par un ou plusieurs des examens complémentaires suivants.
La manométrie anorectale
La manométrie anorectale permet une évaluation objective de la fonction sphinctérienne et de la sensibilité rectale. À noter que, dans environ 25 % des cas, les pressions sont normales : il s’agit alors d’une incontinence à pressions normales, justifiant une réévaluation clinique à la recherche d’une cause extra-anale (colique, iatrogène, diarrhée).
L’échographie endo-anale
L’échographie endo-anale est l’examen de référence pour analyser avec précision l’anatomie des sphincters anaux. Une rupture est considérée comme significative lorsqu’elle s’étend sur au moins 90°. La faisabilité d’une réparation dépend de l’étendue, avec une limite généralement située entre 120° et 160°, selon les équipes. Cet examen joue donc un rôle déterminant dans la prise de décision thérapeutique devant une IA.
La colpocystodéfécographie (CCD) et la déféco-IRM
La colpocystodéfécographie (CCD) et la déféco-IRM sont des examens à la fois morphologique et fonctionnel qui jouent un rôle limité dans le bilan.
L’électromyogramme
L’électromyogramme (EMG) permet d’évaluer la localisation, le mécanisme et la sévérité des atteintes nerveuses (périphériques ou centrales) impliquées. Dans les cas complexes, notamment en présence d’une pathologie neurologique, l’EMG et les autres tests neurophysiologiques précisent le type et le niveau de l’atteinte (nerf sensitif, racine, moelle, plexus…). La mesure de la latence distale motrice du nerf pudendal permet de détecter une neuropathie canalaire de ce nerf. En pratique, ces explorations EMG sont de moins en moins utilisées en routine pour l’IA, mais gardent leur intérêt dans les cas spécifiques ou médico-légaux.
Des traitements non invasifs de seconde ligne…
Face à une IA résistante à la régulation du transit et à la rééducation, le spécialiste dispose de solutions conservatrices non invasives que le patient peut utiliser en autonomie.
Stimulation tibiale postérieure par TENS : un traitement bien toléré
La stimulation tibiale postérieure par TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) est réalisée à domicile par le patient à l’aide d’électrodes placées sur le trajet du nerf tibial postérieur. Son mécanisme d’action reste mal compris, mais impliquerait des réflexes somato-sympathiques et une modulation de la sensibilité rectale. Elle permettrait ainsi d’améliorer la continence par voie neurologique. Ce traitement doit être pratiqué quotidiennement pendant 20 minutes sur une durée minimale de trois mois. Les études disponibles rapportent des résultats variables, avec des taux de succès allant de 30 à 80 % [7]. Cette méthode reste simple, bien tolérée, peu coûteuse et utilisable à long terme en cas de réponse, bien qu’aucun protocole standardisé ne soit encore défini. L’appareil (loué puis acheté si la technique est efficace) est pris en charge par l’Assurance maladie.
Irrigation transanale : pour une meilleure qualité de vie
L’irrigation transanale (ITA) [8], via le système Peristeen, est utilisée principalement chez les patients souffrant de troubles neurologiques avec difficultés d’évacuation de l’ampoule rectale, constipation et IA. Il n’y a pas de hiérarchisation entre le TENS et l’ITA, ni d’indication particulière de l’une de ces techniques par rapport à l’autre. L’ITA consiste à effectuer un lavement étanche un jour sur deux avec obtention d’une vacuité complète du colon gauche qui permet une amélioration des symptômes digestifs (dans environ 60 % des cas) et de la qualité de vie. Son efficacité est démontrée même à long terme. Le principal facteur d’échec est le manque d’adhésion du patient, soulignant l’importance de l’éducation. La première prescription doit être faite par un spécialiste, mais le renouvellement peut être assuré par le médecin traitant. Ce dispositif est pris en charge par l’Assurance maladie.
Des tampons pour rassurer
Les tampons obturateurs anaux peuvent également représenter une aide précieuse au quotidien, en particulier sur le plan social, en rassurant les patients et en améliorant leur qualité de vie. Toutefois, il n’en existe actuellement plus aucun qui soit remboursé par l’Assurance maladie, ce qui représente un coût non négligeable s’ils sont utilisés régulièrement.
Briser le tabou, c’est déjà soulager !
L’IA est une pathologie fréquente, souvent tue, mais rarement sans solution. Son dépistage actif est indispensable pour améliorer la qualité de vie des patients. Trop de malades n’osent pas en parler, et trop de médecins ne posent pas la question. Pourtant, des solutions simples, efficaces et peu coûteuses existent, et la prise en charge par des méthodes conservatrices et non invasives peut déjà permettre une amélioration significative dans la majorité des cas. Le médecin généraliste a un rôle crucial dans cette approche initiale, qu’il faut valoriser, décomplexer et accompagner.
Photo - Fistule

[1] Bharucha AE, Knowles CH, Mack I, Malcolm A, Oblizajek N, Rao S, Scott SM, Shin A, Enck P. Faecal incontinence in adults. Nat Rev Dis Primers., 2022 Aug 10;8:53
[2] Damon H, Guye O, Seigneurin A, Long F, Sonko A, Faucheron JL, Grandjean JP, Mellier G, Valancogne G, Fayard MO, Henry L, Guyot P, Barth X, Mion F. Prevalence of anal incontinence in adults and impact on quality-of-life. Gastroenterol Clin Biol., 2006 Jan;30:37-43
[3] Skaug KL, Engh ME, Frawley H, Bø. Prevalence of Pelvic Floor Dysfunction, Bother, and Risk Factors and Knowledge of the Pelvic Floor Muscles in Norwegian Male and Female Powerlifters and Olympic Weightlifters. J Strength Cond Res., 2022 Oct 1;36:2800-2807
[4] Vitton V, Soudan D, Siproudhis L, Abramowitz L, Bouvier M, Faucheron JL, Leroi AM, Meurette G, Pigot F, Damon H; French National Society of Coloproctology. Treatments of faecal incontinence: recommendations from the French national society of coloproctology. Colorectal Dis., 2014 Mar;16:159-166
[5] Soudan D, Alam A, Basile G, Bataillon C et al. Anorectal physiotherapy in coloproctology: Guidelines of the french national society of coloproctology. Clin Res Hepatol Gastroenterol., 2025 Jul-Aug;49:102637
[6] Demirci S, Gallas S, Bertot-Sassigneux P, Michot F, Denis P, Leroi AM. Anal incontinence: the role of medical management. Gastroenterol Clin Biol., 2006 Aug-Sep;30:954-960
[7] Horrocks EJ, Bremner SA, Stevens N, Norton C, Gilbert D, O'Connell PR, Eldridge S, Knowles CH. Double-blind randomised controlled trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus sham electrical stimulation in the treatment of faecal incontinence: CONtrol of Faecal Incontinence using Distal NeuromodulaTion (the CONFIDeNT trial). Health Technol Assess., 2015 Sep;19:1-164
[8] Mekhael M, Kristensen HØ, Larsen HM, Juul T, Emmanuel A, Krogh K, Christensen P. Transanal Irrigation for Neurogenic Bowel Disease, Low Anterior Resection Syndrome, Faecal Incontinence and Chronic Constipation: A Systematic Review. J Clin Med., 2021 Feb 13;10:753

 12 minutes
12 minutes Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire






Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.