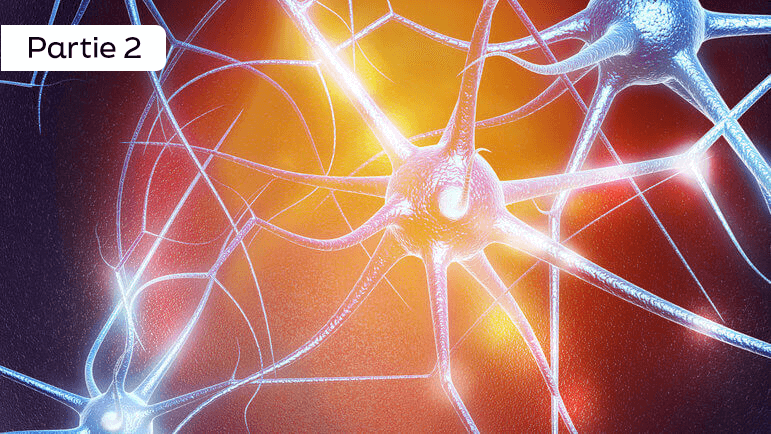
Tous les types d’IA sont susceptibles de répondre à la neuromodulation sacrée. bluebay2014/ iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Lorsque les traitements conservateurs de première ligne (régularisation du transit et rééducation périnéale) échouent (cf. notre article
La neuromodulation sacrée constitue un
- réponse chez deux patients sur trois
- approche en deux temps : phase de test puis implantation définitive
- mécanisme d'action via des réflexes somato-sympathiques
- indication pour les patients ayant au moins un épisode d'incontinence hebdomadaire.
La toxine botulique représente une option émergente :
- efficacité dans environ 70
- durée d'action de 4 à 5 mois
- avantages en termes de simplicité, de
L'irrigation colique antérograde offre une solution efficace particulièrement adaptée aux patients neurologiques
- taux de succès de 90
Les agents comblants (dont la diffusion est encore limitée)
- efficacité variable (40-67
- alternative : technique «
La chirurgie reste indiquée dans des cas spécifiques
- sphinctérorraphie pour les ruptures du sphincter anal externe (de 70 à 80
- rectopexie ventrale en cas de prolapsus rectal
- une colostomie peut être envisagée en dernier recours pour améliorer la qualité de vie.
La thérapie cellulaire constitue une piste prometteuse
- visant
- premiers essais cliniques encourageants
- défis à relever : sélection des patients, standardisation, sécurité à long terme et coût élevé.
une régularisation du transit associée à une rééducation périnéale permet une amélioration significative auprès de la majorité des patients souffrant d'incontinence anale (IA). En cas d'échec des traitements conservateurs de première ligne qui peuvent aussi comporter une neurostimulation tibiale ou une irrigation colique (cf. notre article « Incontinence anale et traitements de première ligne : une amélioration dans la majorité des cas » [partie 1]), des approches plus ou moins invasives sont proposées.
Neuromodulation sacrée : un traitement mini-invasif de référence
La neuromodulation sacrée est un traitement mini-invasif remboursé par la sécurité sociale depuis une quinzaine d'années qui peut améliorer les patients souffrant d'IA quelle qu'en soit la cause. Cette approche est devenue une référence dans la prise en charge de l’IA avec une réponse positive chez environ deux patients sur trois et un recul de plusieurs années [1]. Cependant, aucun facteur prédictif particulier de réponse n’a été mis en évidence.
La neuromodulation agit probablement via des réflexes somato-sympathiques en stimulant les nerfs sacrés à l’aide d’une électrode implantée près du foramen sacré, reliée à un boîtier placé sous la peau en région lombaire. Elle n’agit pas simplement sur le sphincter, mais sur le transit.
Le traitement se déroule en deux temps : une phase de test de 15 jours à 3 semaines avec une électrode connectée à un boîtier externe ; puis, en cas d’amélioration (une réduction ≥ 50 % des épisodes d’IA), une implantation définitive du boîtier sous anesthésie. La durée de vie du dispositif est estimée entre 5 et 8 ans, avec possibilité d’ajuster les réglages avec une télécommande.
La neuromodulation sacrée est indiquée chez les patients présentant au moins un épisode d’incontinence par semaine, après échec des traitements conservateurs, y compris en cas de rupture sphinctérienne. Elle peut aussi être proposée en cas de double incontinence, anale et urinaire. Le traitement est mis en place au bloc sous anesthésie locale et scopie.
Toxine botulique : une option simple et bien tolérée
La toxine botulinique est utilisée en proctologie pour traiter les douleurs pelviennes, la fissure anale, la constipation distale ou encore l’incontinence urinaire d’origine neurologique.
Son usage rectal dans l’IA par urgenturie a été exploré dans plusieurs études avec une amélioration significative des symptômes et de la qualité de vie dans près de 70 % des cas avec une durée moyenne d’efficacité de 4 à 5 mois [2].
La toxine botulique, qui commence à être utilisée dans certains centres spécialisés, se distingue par sa simplicité, sa bonne tolérance et son coût modéré, ce qui en fait une option en développement dans la prise en charge de l’IA.
Irrigation colique et lavements à domicile
L’irrigation colique antérograde, réalisée par cæcostomie chirurgicale (technique de Malone) ou endoscopique, permet au patient d’effectuer des lavements coliques à domicile, généralement un jour sur deux.
Cette méthode, principalement indiquée chez les patients atteints de pathologies neurologiques chroniques (enfants ou adultes), est très efficace : environ 90 % chez l’enfant et de 50 à 80 % chez l’adulte [3].
Des agents comblants pour augmenter le tonus anal
Les injections d’agents de comblement (collagène, acide hyaluronique) visent à améliorer le tonus anal, principalement dans les cas d’incontinence passive. Réalisées en sous-muqueux ou dans l’espace intersphinctérien, elles ont des taux de succès variables (de 40 à 67 %), avec un effet parfois transitoire [4].
Une alternative, la technique « Gatekeeper », consiste à insérer des implants de polyacrylonitrile autour du canal anal ; ces implants se dilatent secondairement et améliorent la pression anale. Bien que prometteuse (environ 50 % d’efficacité à 3 ans), cette méthode reste peu utilisée en France à ce jour.
La chirurgie conserve de rares indications
Les traitements chirurgicaux conservent des indications dans certains cas d’IA sévère et après échec des traitements conservateurs.
La sphinctérorraphie (réparation sphinctérienne) reste le traitement de référence en cas de rupture accessible du sphincter anal externe, notamment postobstétricale, avec un taux de succès de 70 à 80 %, bien que les résultats puissent décliner avec le temps [5].
La chirurgie est indiquée en cas de troubles de la statique rectale et, en particulier, les cures de rectopexie ventrale pour le prolapsus total du rectum.
Les techniques de transposition musculaire, comme la graciloplastie et la graciloplastie dynamique (cette dernière n’étant d’ailleurs plus disponible à ce jour) sont désormais rarement proposées en raison de leur lourde morbidité et d’un taux élevé de réinterventions. Les dispositifs mécaniques (sphincter artificiel et le sphincter magnétique) ne sont plus commercialisés.
En dernier recours, une colostomie peut être envisagée. Loin d’être un échec thérapeutique, elle peut améliorer significativement l’autonomie et la qualité de vie de certains patients.
La thérapie cellulaire, une piste prometteuse
La thérapie cellulaire représente une piste novatrice et prometteuse dans le traitement de l’IA, en visant la régénération ou la réparation des tissus lésés. Le terme « cellules souches » recouvre une grande diversité de populations cellulaires, aux capacités variables de différenciation et de prolifération, selon leur origine (tissu hématopoïétique, musculaire ou adipeux).
Dans le cadre de l’IA, la majorité des données publiées proviennent encore de modèles animaux, mais les premiers essais cliniques chez l’homme, y compris randomisés, montrent des résultats encourageants [6]. Les modalités varient selon les études : site d’injection (dans la brèche sphinctérienne ou autour), support utilisé (injection directe ou sur matrice) et parfois association à d’autres approches (électrostimulation).
Les cellules sont le plus souvent d’origine myoblastique, ciblant le sphincter anal externe. Plusieurs études font état d’une amélioration clinique durable, avec un suivi pouvant aller jusqu’à 5 ans. Malgré son potentiel, cette approche soulève encore de nombreuses questions : sélection des patients, type optimal de cellules, standardisation des protocoles, sécurité à long terme (notamment oncologique), sans oublier un coût élevé et une logistique complexe, réservant aujourd’hui ce traitement aux centres experts.
[1] Desprez C, Damon H, Meurette G, Mege D, Faucheron JL, Brochard C et al. Ten-year evaluation of a large retrospective cohort treated by sacral nerve modulation for fecal incontinence: Results of a french multicenter study. Ann Surg., 2022 Apr 1;275:735-742
[2] Leroi AM, Queralto M, Zerbib F, Siproudhis L, Vitton V, Amarenco G et al. Intrarectal injections of botulinum toxin versus placebo for the treatment of urge faecal incontinence in adults (FI-Toxin): a double-blind, multicentre, randomised, controlled phase 3 study. Lancet Gastroenterol Hepatol., 2024 Feb;9:147-158
[3] Ricard J, Quénéhervé L, Lefevre C, Le Rhun M, Chabrun E, Duchalais-Dassonneville E et al. Anterograde colonic irrigations by percutaneous endoscopic caecostomy in refractory colorectal functional disorders. Int J Colorectal Dis., 2019 Jan;34:169-175
[4] Brusciano L, Tolone S, Del Genio G, Grossi U, Schiattarella A, Piccolo FP et al. Middle-term Outcomes of Gatekeeper Implantation for Fecal Incontinence. Dis Colon Rectum, 2020 Apr;63(4):514-519
[5] Okeahialam NA, Thakar R, Sultan AH. Early secondary repair of obstetric anal sphincter injuries (OASIs): experience and a review of the literature. Int Urogynecol J., 2021 Jul;32:1611-1622
[6] Balaphas A, Meyer J, Meier RPH, Liot E, Buchs NC, Roche B et al. Cell Therapy for Anal Sphincter Incontinence: Where Do We Stand? Cells, 2021 Aug 13;10:2086

 6 minutes
6 minutes Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire






Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.