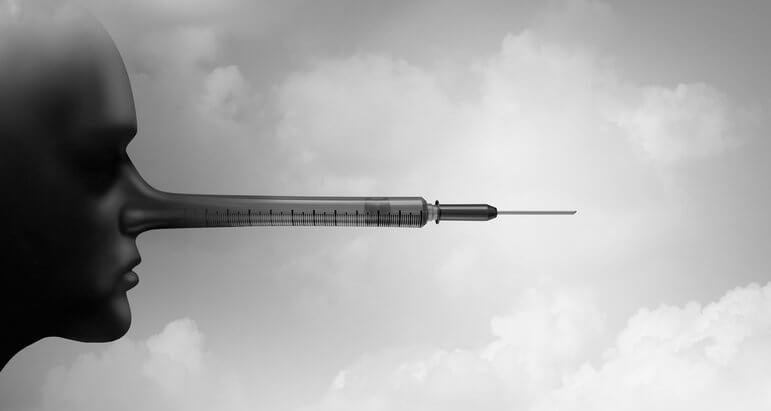
Près d’un Français sur deux a déjà été confronté à une fake news dans le domaine de la santé.wildpixel / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
La distinction entre mésinformation et désinformation réside essentiellement dans l'intentionnalité de l'émetteur.
Selon le ministère de la Santé, près d’un Français sur deux dit avoir été exposé à des informations fausses ou erronées dans le domaine médical.
La littératie en santé implique une démarche critique systématique face aux informations rencontrées.
Par son accessibilité, son expertise scientifique et la relation de confiance qu’il entretient avec ses patients, le pharmacien occupe une position privilégiée pour contrer la désinformation en santé.
Contrairement à ce que l'on a tendance à croire, la circulation d'informations douteuses n'est pas un phénomène propre à notre société. Chaque génération a connu ses récits déformés, enjolivés ou inventés : « j’ai vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours ». De la même manière, les individus demandent, interprètent, cherchent les informations qui corroborent leur point de vue. Autrement dit, la désinformation fait partie de l'histoire humaine [1].
Toutefois, elle circule de plus en plus vite. Vérifiée ou non, elle s'affiche sur nos écrans de télévision, de téléphones portables ou dans nos discussions quotidiennes. Lorsqu'il s'agit de la santé, elle s'invite même au comptoir.
Distinguer l’erreur de la manipulation
La distinction fondamentale entre mésinformation et désinformation réside essentiellement dans l'intentionnalité de l'émetteur.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la mésinformation comme une diffusion d’informations inexactes, sans volonté délibérée de tromper [2]. Elle peut résulter d'une mauvaise compréhension, d’une interprétation inadéquate ou d'une erreur de transmission. L’émetteur est convaincu de la véracité de l’information qu’il donne, il ne présente aucune intention malveillante et peut même être motivé par une volonté d'assistance thérapeutique. Par exemple, un membre de la famille qui partage les bienfaits miraculeux du citron contre toutes les maladies possibles. Il y croit, et veut juste le recommander en toute bienveillance.
La désinformation, en revanche, est délibérément conçue pour induire en erreur avec l’intention de nuire. Elle se distingue de l’information malveillante, qui, malgré la même finalité (porter préjudice à une personne ou une institution), implique la diffusion d’une information factuellement exacte. Par exemple, la transposition d'informations de la sphère privée à la sphère publique, notamment concernant des données médicales personnelles.
Les fake news, ou infox, englobent l'ensemble de ces fausses informations diffusées.
En définitive, qu’elle soit le fruit d’une erreur ou d’une intention trompeuse, la diffusion de fausses informations influence directement les comportements. L’exposition à ces contenus compromet la prévention, altère la prise en charge et érode la confiance dans les professionnels de santé. La pandémie de Covid-19 en a fourni l’illustration la plus emblématique, où « l’infodémie » a précédé l’épidémie (cf. Encadré 1).
| La pandémie de Covid-19 a offert un terrain particulièrement propice à la propagation de la désinformation : un climat mondial d’anxiété, d’incertitude et de doute, conjugué à une accessibilité inédite de l’information. Au fur et à mesure, une multitude d'allégations non fondées ont émergé sur les réseaux sociaux et se sont propagées, par les messageries instantanées, alimentant le scepticisme à l’égard des traitements, de la sécurité et l'efficacité des vaccins, et questionnant la pertinence des mesures de distanciation physique. Ces dynamiques ont contribué à retarder l’adhésion à la vaccination, à attiser les tensions sociales et, dans certains cas, ont conduit à des taux de mortalité plus élevés. |
Mécanismes de la désinformation
Lors de la huitième édition du congrès national francophone d’oncologie (Ifods), Roman Bornstein, directeur des études à la Fondation Jean-Jaurès, a proposé une grille de lecture simple : pour qu’il y ait désinformation, il faut trois acteurs :
- le désinformateur, qui agit en toute connaissance de cause, avec l'intention volontaire de tromper et de nuire. Il peut être animé par différents moteurs, que ce soit l’appât du gain, des motivations politiques, idéologiques ou religieuses ;
- le diffuseur, ensuite, qui relaie l’information auprès du consommateur. En particulier, les réseaux sociaux, conçus pour maximiser l'engagement et susciter des réactions, repèrent, par leurs algorithmes, ce qui nous émeut, et particulièrement ce qui suscite de la peur, de la colère ou de l'indignation ;
- le consommateur va alors cliquer, commenter et partager. Sans vérifier la source de l'information, il contribue à la diffusion, devenant lui-même désinformateur. Une étude, publiée dans Science en 2018, démontrait que les fausses informations circulaient près de 6 fois plus vite que les vraies [3].
La désinformation en santé constitue un phénomène préoccupant, tant par sa propagation que par ses conséquences. Près d'un Français sur deux (47 %) dit y avoir été exposé dans le domaine de la santé (+10 points par rapport à 2020), tandis que 35 % estiment qu’il est difficile de trouver des informations fiables en la matière [4, 5].
Cette exposition constante n’est pas sans effet : parmi les personnes ayant déjà rencontré une fake news en santé, 43 % affirment avoir pris au moins une décision fondée sur cette information erronée, un constat d’autant plus alarmant que ce chiffre monte à 60 % chez les moins de 35 ans. Malgré tout, les Français privilégient encore les professionnels de santé : 71 % déclarent consulter leur médecin pour obtenir une information fiable, tandis que 44 % se tournent vers leur pharmacien, soulignant leur importance comme remparts contre la désinformation [4, 5].
Lutter contre la désinformation en santé
Pour se prémunir de la désinformation, la littératie constitue un déterminant fondamental. L’OMS la définit comme « l'ensemble des connaissances et compétences personnelles acquises au fil des activités quotidiennes, des interactions sociales et au fil des générations. Ces connaissances et compétences personnelles sont transmises par les structures organisationnelles et la disponibilité des ressources qui permettent aux individus d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'utiliser l'information et les services de manière à promouvoir et à maintenir une bonne santé et un bon bien-être pour eux-mêmes et leur entourage » [6].
En d’autres termes, c’est le fait d’être capable d’accéder, de comprendre, d’évaluer et d’utiliser l’information de manière à promouvoir et maintenir sa santé et son bien-être. Sans se limiter à la consultation de sites web, à la lecture de brochures ou à l’adoption mécanique de comportements en santé recommandés, elle comprend la capacité à réfléchir de manière critique, ainsi qu'à interagir et à exprimer les besoins personnels et sociétaux en matière de promotion de la santé.
Dans le contexte spécifique de la lutte contre la désinformation en santé, le développement de cette littératie constitue un prérequis essentiel, permettant l'acquisition des outils cognitifs nécessaires à l'évaluation critique des informations rencontrées.
Au fil du temps, la relation pharmacien-patient a évolué : conseils en matière de nutrition, accompagnement dans la prise en charge des maladies chroniques, mais aussi missions de prophylaxie, allant du test d’orientation diagnostique à la vaccination. L’officine est au cœur de la santé publique, jouant son rôle à tous les niveaux de la prévention. Par son accessibilité, son expertise scientifique et la relation de confiance qu’il entretient avec ses patients, le pharmacien occupe une position privilégiée pour contrer la désinformation en santé.
Le pharmacien, dispensateur et médiateur
D’une façon générale, que ce soit pour les professionnels de santé ou pour les patients, il faut faire preuve de réflexion critique et prendre le temps nécessaire avant de diffuser toute information. Une démarche d'analyse systématique s'impose :
- ce contenu est-il fiable ? Évaluation de la validité scientifique, de la méthodologie employée et de la concordance avec le corpus de connaissances établi ;
- qui est l'auteur(e) ? Identification des qualifications, affiliations institutionnelles, et potentiels liens d'intérêts ;
- quelle est la source des allégations ? Vérification de l'origine des données, distinction entre faits empiriques, hypothèses et opinions ;
- le point de diffusion de l'information est-il fiable ? Évaluation critique du vecteur informationnel (revue scientifique à comité de lecture, média généraliste, réseau social) ;
- quel est mon ressenti par rapport à cette information ? Prise de conscience des biais cognitifs personnels pouvant influencer l'interprétation.
Au comptoir, le pharmacien peut orienter les patients vers des sources vérifiées. Parmi elles, les communications officielles du ministère de la Santé, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), des agences régionales de santé (ARS), de la Sécurité sociale, de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ou encore les publications de l’OMS.
Néanmoins, à l’officine, le dialogue se heurte à des contraintes pratiques. En moyenne, le temps d'interaction au comptoir est compté, d’autant plus en période d’affluence, limitant considérablement les opportunités de déconstruire un mythe.
La lutte contre la désinformation en santé constitue désormais un enjeu majeur de santé publique à l'échelle internationale, nécessitant une approche multidimensionnelle et coordonnée. L'amélioration de la littératie en santé s'impose comme un axe stratégique prioritaire dans l'agenda européen, comme en témoigne son intégration dans des documents officiels tels que le livre blanc de la Commission européenne « Ensemble pour la santé ». De son côté, l’OMS propose divers outils pour contrer efficacement désinformation et mésinformation. Par exemple, la valorisation de sources d’information validées scientifiquement.
En France, cette problématique fait l'objet d'une mobilisation institutionnelle concrétisée par la création récente de l'Observatoire national de la désinformation en santé. Dans ce cadre, le professeur Mathieu Molimard, pharmacologue et chef de service au CHU de Bordeaux, la professeure Dominique Costagliola et le docteur Hervé Maisonneuve, ont été missionnés par le ministère de la Santé pour élaborer une stratégie nationale de lutte contre l'obscurantisme et la désinformation médicale. Le rapport, attendu en décembre 2025, formulera des recommandations opérationnelles visant à renforcer et pérenniser une politique nationale cohérente.
[1] Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity (OECD, 4 mars 2024)
[2] Désinformation et santé publique (Organisation mondiale de la santé, 6 février 2024)
[3] Vosoughi S et al. The spread of true and false news online. Science, 2018 ; 359 : 1146-1151. DOI : 10.1126/science.aap9559
[4] Lutte contre la désinformation en santé : une priorité du ministère (Ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, 6 mai 2025)
[5] Les fake news dans le domaine de la santé (Verian, Harmonie santé, Inserm, 2025)

 8 minutes
8 minutes Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire




