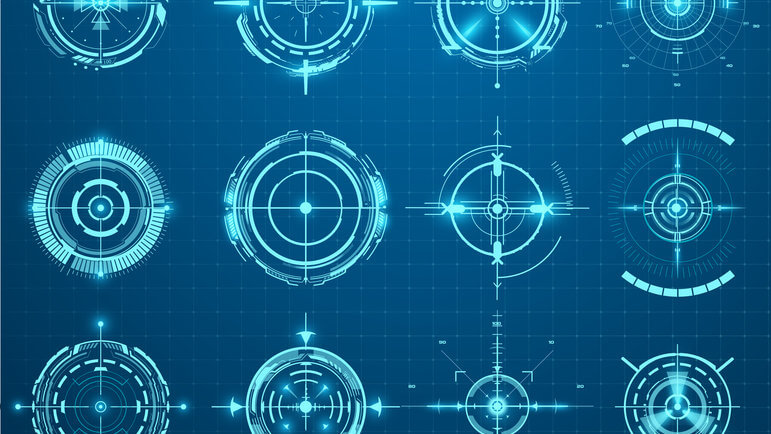
Légende à faire.NatalyaBurova / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
La radiothérapie est une arme thérapeutique majeure dans le traitement des cancers et plus de 60 % des patients y ont recours. Son développement, ces dernières décennies, a permis une amélioration du contrôle local des tumeurs et une nette réduction de ses effets secondaires aussi bien aigus que tardifs. Ces progrès se sont également accompagnés d'un allégement des schémas de traitement avec une réduction drastique du nombre de séances puisque les traitements sont à ce jour couramment délivrés selon des schémas hypofractionnés modérés (15-20 séances) ou hypofractionnés extrêmes (4-5 séances).
Aujourd’hui, l'oncologie radiothérapie poursuit son évolution vers une plus grande personnalisation des traitements, en intégrant des données nouvelles d’imagerie, de biologie. La poursuite de l’intégration de l’imagerie, en particulier IRM, permet d’envisager l’expansion de la radiothérapie adaptative : tenir compte des variations anatomiques quotidiennes en cours de séance avec recalcul de la dose en temps réel. Enfin, le développement de la protonthérapie et des modalités de délivrance des faisceaux, en particulier des modalités dites FLASH, sont des éléments qui dessineront la radiothérapie de demain avec toujours pour perspectives : personnaliser les traitements, améliorer l’efficacité et réduire les effets secondaires.
C'est avec le Pr Gilles Créhange, chef de département d'oncologie radiothérapie de l'Institut Curie, que nous développerons l'avenir de l’oncologie radiothérapie, avec actuellement trois principales évolutions : la radiothérapie adaptative, les nouveaux rayonnements et la radiothérapie FLASH.
Quelles ont été les grandes avancées de la radiothérapie ces dernières décennies ?
Les principaux progrès de la radiothérapie sont liés à l’apparition de nouvelles techniques de traitement telles que la radiothérapie conformationelle en modulation d’intensité (RCMI) et la radiothérapie corporelle en conditions stéréotaxiques (SBRT), couplées à la radiothérapie guidée par l’image (IGRT).
- La radiothérapie conformationelle en modulation d’intensité (RCMI) a permis une meilleure conformation des faisceaux d'irradiation aux volumes cibles (VC) et une meilleure épargne des organes à risques (OAR). Cela s’est traduit par une diminution de la toxicité aiguë et tardive, quelle que soit la localisation. Aujourd’hui, ce traitement est délivré beaucoup plus rapidement (en quelques minutes) grâce à la technique VMAT (arcthérapie rotationnelle dynamique) qui a remplacé la RCMI « step-and-shoot » ou la RCMI dynamique dite « sliding windows » qui utilisait des champs fixes.
- La radiothérapie corporelle en conditions stéréotaxiques (SBRT) permet de délivrer de très fortes doses dans des volumes réduits ouvrant la voie aux stratégies d’escalade de dose dans la tumeur tout en préservant les OAR avec l’avantage de nécessiter peu de séances (de 3 à 5 séances).
- La radiothérapie guidée par l’image (IGRT) correspond à l’intégration, dans les accélérateurs de particules Linac (Linear Accelerator), de systèmes d’imagerie embarqués de façon à obtenir soit des clichés orthogonaux de rayons X pour cibler des structures osseuses ou des marqueurs métalliques (2D), soit l’équivalent d’une imagerie scanner embarquée dite Cone-Beam CT (CBCT), permettant en plus la visualisation 3D de l’ensemble des tissus mous. Maintenant, il existe des machines possédant une IRM embarquée, permettant la visualisation des conditions anatomiques à chaque séance et de vérifier la position de la tumeur par rapport à celles des OAR.
L’IRM a l’avantage d’être non irradiante et de mieux caractériser l’anatomie et les rapports entre les organes que le scanner, qui est parfois grevé de plus d’incertitudes anatomiques. Cela permet de s’assurer quotidiennement que le traitement va être délivré de manière conforme à la dosimétrie initiale : les volumes à cibler sont bien centrés dans les faisceaux d’irradiation en temps réel et les OAR le plus éloignés possible. L’exemple type est celui des irradiations de la prostate où le volume de la vessie et du rectum sont surveillés chaque jour pour s’assurer qu’ils restent le plus à distance des zones de fortes doses et que la dose reçue tout au long du traitement corresponde à celle prévue lors de la planification de traitement initiale.
Quels sont les bénéfices cliniques de ces évolutions techniques ?
La RCMI, la stéréotaxie (SBRT) et l’IGRT sont désormais des techniques incontournables sur les plateaux techniques de radiothérapie. Le gain premier concerne la réduction des effets secondaires aigus et tardifs en particulier sévères, quelle que soit la localisation, même si des progrès importants restent encore à mener. Citons juste quelques exemples qui ont véritablement changé le quotidien des patients :
- impact moindre sur l’état général ;
- réduction des xérostomies et troubles de la déglutition dans les irradiations ORL ;
- réduction des cystites et rectites radiques dans les irradiations pelviennes ;
- diminution des radio-épithélites dans les irradiations mammaires, ORL, gynécologiques ;
- préservation des fonctions cognitives dans les irradiations cérébrales.
La SBRT a rendu possible le traitement des métastases, quel que soit leur site : cérébral, hépatique, pulmonaire, ganglionnaire, rénal… L’indication d’un traitement focal peut être désormais discuté en situation oligométastatique (< 5 métastases). Ce traitement dit ablatif, mais non invasif, avec un excellent contrôle local et un profil de tolérance tout aussi satisfaisant, challenge les techniques chirurgicales et radio-interventionnelles. Par comparaison avec la chirurgie ou d’autres techniques ablatives, la SBRT a montré des taux de contrôle local ou de survie équivalents, avec une meilleure qualité de vie et parfois moins de complications dans un certain nombre d’indications (cancer du rein, de prostate, du poumon…).
La capacité à mieux maîtriser les conditions de délivrance des traitements et de protection des OAR a autorisé à augmenter la dose par séance et diminuer le nombre total de séances. Les traitements hypofractionnés modérés (15-20 séances) ou hypofractionnés extrêmes (1-5 séances) se généralisent et sont devenus des standards dans certaines localisations. Le contrôle local est au moins identique et sans majoration de la toxicité par rapport aux traitements normofractionnés. La réduction drastique du nombre de séances offre un gain en termes de qualité de vie pour les patients, mais aussi une meilleure utilisation des ressources et une diminution du coût et de l’impact sur l’environnement, compte tenu de la réduction des trajets quotidiens sur plusieurs semaines.
Quelles sont les localisations qui bénéficient des traitements hypofractionnés ?
Les schémas hypofractionnés sont en cours d’évaluation dans toutes les localisations, mais c’est dans le cancer du sein, de la prostate et du poumon qu’ils ont commencé par s’imposer :
- pour le cancer du sein, les schémas tels que 40 Gy en 15 séances sur 3 semaines ou 26 Gy en 5 séances sur 1 semaine sont couramment utilisés, avec une efficacité et une tolérance démontrées [1] ;
- pour le cancer de la prostate, l’hypofractionnement modéré (60 Gy en 20 fractions) et l’hypofractionnement extrême par stéréotaxie en 5 séances sont validés, offrant des résultats oncologiques équivalant au fractionnement conventionnel, sans augmentation significative de la toxicité [2] ;
- pour le cancer du poumon non à petites cellules localisé, la radiothérapie stéréotaxique en 3 à 5 séances est le standard chez les patients non opérés : le contrôle local est comparable à celui de la chirurgie avec une toxicité acceptable [3]. Dans les stades localement avancés (stade III), l’hypofractionnement modéré (60 Gy en 15 fractions de 4 Gy) est en cours d’évaluation, notamment en association avec la chimiothérapie et l’immunothérapie, avec des résultats prometteurs en termes de survie et de tolérance [4].
Quels sont aujourd'hui les principaux développements en radiothérapie et les progrès prochainement attendus ?
Comme les autres disciplines, l’oncologie radiothérapie évolue vers une plus grande personnalisation grâce à l’intégration des données biologiques, d’imagerie, qui permettront une sélection plus fine des indications, l’identification de facteurs prédictifs de l’efficacité et aussi de la toxicité…
Mais c’est probablement les concepts de radiothérapie adaptative (ART) guidée par l’anatomie pendant la séance ou de radiothérapie adaptative guidée par des biomarqueurs prédictifs d’une radiosensibilité de la tumeur et des tissus de chaque patient qui devraient ouvrir la voie de la radiothérapie personnalisée.
Les bénéfices de la radiothérapie décrits ci-dessus devraient également concerner dans le futur, la protonthérapie, encore trop coûteuse pour se développer, mais dont les avantages balistiques pour diminuer les risques de rechute ou de seconds cancers restent optimaux pour des tumeurs radiorésistantes, mal placées ou chez l’enfant.
Enfin, le fractionnement de la dose dans le temps (radiothérapie dite FLASH à ultra-haut débit de dose) ou fractionnée dans l’espace (radiothérapie par minifaisceaux) devrait permettre d’obtenir des effets biologiques protecteurs sur les tissus sains environnants avec l’espoir d’une amélioration de l’index thérapeutique chez l’homme dans le futur. En tout cas, les expérimentations chez l’animal sont extrêmement prometteuses à ce stade.
Tous ces bénéfices obtenus ou attendus font qu’il est aujourd’hui possible de réirradier de plus en plus de patients présentant une rechute locale ou un second cancer en terrain irradié. Cela offre de nouvelles opportunités de contrôle local dans des situations où la chirurgie n'est pas envisageable et/ou la chimiothérapie aurait un rôle exclusivement palliatif.
À quoi correspond la radiothérapie adaptative ? Quels bénéfices peut-on en attendre ?
Aujourd'hui, tous les paramètres techniques d’un plan de traitement sont définis à partir d'un scanner dosimétrique et sont reproduits à l'identique à chaque séance, mais sans véritablement tenir compte des modifications anatomiques :
- la régression tumorale ;
- les modifications de la morphologie du patient (perte de poids) ;
- le déplacement des organes à risque (mouvements respiratoires) ;
- la variation physiologique des volumes d’une séance à l’autre et aussi en cours de séance (volumes de la vessie et du rectum).
Du fait de ces variations, les champs d’irradiation incluent des « marges », ce qui expose davantage les OAR et donc au risque de survenue d’effets secondaires. La radiothérapie adaptative (ART) correspond à l’ensemble des dispositifs qui permettent de tenir compte de toutes ces variations [5]. Elle peut se dérouler de trois manières :
- « off line » : les adaptations des champs d’irradiations se font en dehors du temps de traitement. Elles permettent, après l’analyse des premières séances, de définir des marges personnalisées ;
- « hybride off line - on line » : plusieurs plans de traitement sont préparés avec des positions différentes des OAR. Une imagerie cone-beam CT (CBCT) est effectuée chaque jour. Le plan de traitement le plus proche de l’anatomie du jour est choisi pour le traitement ;
- « on line » : à chaque séance, une imagerie CBCT ou IRM est réalisée. Les contours des VC et OAR sont réadaptés à l’anatomie du jour et le plan de traitement est intégralement recalculé.
C’est vers la modalité « on line » que ce fait l’évolution actuelle. Une nouvelle génération d’appareils a vu le jour. Ils intègrent aux Linac des systèmes d’imagerie CBCT tel quel le système Ethos (Varian) ou bien des IRM. Dans ce dernier cas, on parle de radiothérapie adaptative guidée par IRM (RM-ART), 2 IRM-Linac étant disponibles en France : MRIdian (ViewRay) avec une IRM de 0,35 T et Unity (Elekta) avec une IRM de 1,5 T.
L’image IRM offre une définition des VC et OAR plus précise que le scanner. Les modes d’acquisition dynamique « Ciné-IRM » permettent, alors que le faisceau d’irradiation est en cours, de suivre en direct les mouvements des différents volumes et d’interrompre ou d’adapter le faisceau si nécessaire. L’essor de la RM-ART a été rendu possible grâce à l’intégration d’outils d’intelligence artificielle (IA) tels que l’autosegmentation des VC et OAR et leur adaptation à l’anatomie du jour, la possibilité de refaire un calcul dosimétrique immédiat et de suivre les déplacements de la cible en cours d’irradiation.
Si une planification dosimétrique initiale reste nécessaire sur IRM en position de traitement, les séances ne sont plus la simple reproduction du plan de traitement, mais son adaptation en temps réel en fonction de l’anatomie du jour, de la manière suivante :
- acquisition d’une nouvelle séquence IRM par les manipulateurs ;
- adaptation des contours des VC et OAR par IA, vérifiés et adaptés par l’oncologue radiothérapeute ;
- calcul dosimétrique du jour par IA, contrôlé et validé par le physicien médical ;
- traitement sous contrôle d’une imagerie dynamique type « gating » ou « tracking », sous la surveillance des manipulateurs.
Dans quelles localisations la radiothérapie adaptative est-elle utilisée ?
C’est dans le cancer de la prostate que la RM-ART s’est le plus développée [6]. L’essai MIRAGE a montré une réduction de la toxicité aiguë digestive et urinaire dans les radiothérapies stéréotaxiques prostatiques délivrant 40 Gy en 5 fractions, comparativement au même traitement délivré sur Linac conventionnel [7]. Des perspectives sont ouvertes vers la stratégie d’escalade de dose sur la tumeur index et l’évaluation de la préservation de la fonction érectile (ERECT ; NCT04861194).
Elle semble également particulièrement intéressante dans les localisations abdominopérinéales ou les organes à risque sont très sensibles aux rayons, souvent mobiles à cause de la respiration (foie, surrénale…) ou en raison de leur fonction et physiologie propre (duodénum, colon, grêle, rectum, vessie). Elle rend accessible certaines tumeurs à des stratégies d’escalade de dose.
C’est le cas dans le cancer du pancréas ou la radiothérapie est actuellement indiquée en association à une chimiothérapie concomitante dans les formes localement avancées non opérables ou dans certains cas de cancer borderline, avec des doses limitées à 50,4-54 Gy en fraction de 2 Gy (28 fractions). La RM-ART permet une escalade de dose en stéréotaxie et de délivrer 50 Gy en 5 fractions de 10 Gy soit un équivalent de 82 Gy (a/b=10) si le traitement était délivré en 42 fractions de 2 Gy. Cette escalade de dose permettrait un meilleur contrôle local sans majorer la toxicité digestive [8].
Dans les tumeurs primitives ou secondaires du foie, la RM-ART prend également une part croissante. L’imagerie IRM permet une meilleure définition des VC et OAR (foie, duodénum, côlon, estomac, voies biliaires…). Le suivi des mouvements de la tumeur liés à la respiration est réalisé à partir de séquences dynamiques, ce qui évite la mise en place de fiduciaires (repères radio-opaques qui serviront au repositionnement des faisceaux de traitement à chaque séance), de compressions abdominales ou de dispositifs d’asservissement respiratoire très contraignants pour le patient [9].
L’expansion de la RM-ART ne se limite pas à ces trois cas, de nombreuses indications sont en cours d’évaluation. Citons quelques exemples :
- les tumeurs du rein et de la surrénale déjà traitées en stéréotaxie avec un excellent contrôle local, challengeant les techniques radio-interventionnelles et la chirurgie ;
- les irradiations ganglionnaires isolées ;
- les rechutes en territoire irradié, actuellement difficile d’accès à un retraitement ;
- les tumeurs du col de l’utérus en cas d’impossibilité de réaliser une curiethérapie ;
- l’escalade de dose dans les tumeurs du rectum dans un but de conservation d’organe ;
- les tumeurs thoraciques centrales pour mieux protéger le cœur, le médiastin ;
- les tumeurs cérébrales primitives dont les volumes peuvent être réduits en cours de traitement.
Cette technologie complexe s’intègre-t-elle facilement sur un plateau technique de radiothérapie ?
La place réelle des procédures adaptatives est en cours d’évaluation et elles doivent être comparées aux irradiations conventionnelles. Bien qu'elles soient très séduisantes, il reste à définir leurs bénéfices réels par rapport aux techniques actuelles et à mieux sélectionner les patients.
Les dispositifs d’ART n’ont pas vocation à remplacer les Linac actuels. Ils viennent incrémenter les plateaux techniques et s’ils offrent des opportunités, ils ne sont pas dénués de contraintes :
- les IRM-Linac nécessitent des bunkers spécifiques compatibles à la fois aux contraintes de radioprotection du Linac et à celles liées au champ électromagnétique de l’IRM ;
- les processus adaptatifs améliorent la qualité des traitements, mais restent encore longs, avec des séances de 45-60 min, voire plus, contre 10-20 min actuellement. Il faut s’assurer que les patients peuvent tenir pendant les séances et il est difficile de traiter plus de 10-12 patients par jour ;
- en plus des deux manipulateurs présents pour les traitements sur Linac conventionnel, un oncologue radiothérapeute et un physicien médical doivent être présents en permanence, ce qui alourdit les effectifs et suppose un personnel spécifiquement formé ;
- les coûts des équipements sont relativement élevés et la tarification non encore établie.
Qu’apporte l’utilisation des rayonnements protons ? Que faut-il en attendre ?
La radiothérapie décrite précédemment est délivrée à l’aide de photons, mais d’autres rayonnements sont utilisés, en particulier les protons. La France dispose de trois sites de traitement : Orsay (Institut Curie), Nice (Institut méditerranéen de protonthérapie [IMPT]) et Caen (Centre Francois Baclesse).
Les protons ont une caractéristique physique unique appelée « pic de Bragg », qui fait qu’ils peuvent déposer la majorité de leur énergie à une profondeur précise dans les tissus, correspondant à la localisation de la tumeur, et une dose minimale aux tissus sains situés au-delà de la cible. Cette propriété permet de réduire l’irradiation des tissus sains et des organes critiques adjacents, diminuant ainsi le risque de toxicités aiguës et tardives, ainsi que celui de cancers secondaires induits par la radiothérapie.
Les protons sont accélérés à des énergies thérapeutiques (généralement de 70 à 250 MeV) à l’aide d’un cyclotron ou d’un synchrotron, puis dirigés vers la tumeur via un système de guidage et de modulation du faisceau selon deux modalités :
- la protonthérapie par diffusion passive ;
- la protonthérapie par balayage de faisceau crayon (« pencil beam scanning »), cette dernière permettant une modulation plus précise de la dose.
La protonthérapie est particulièrement indiquée dans certains sarcomes ou mélanomes oculaires ou pour les tumeurs situées près de structures sensibles où la préservation des tissus sains est essentielle (cerveau, moelle épinière, yeux). Chez l’enfant, elle réduit les effets secondaires endocriniens et neurocognitifs, sans différence significative de survie à 5 ans par rapport aux photons [10].
Dans les cancers de la tête et du cou, elle diminue les toxicités (mucite, dysphagie, fatigue, douleur, perte de poids) [11].
Pour les cancers de l’œsophage, les essais randomisés et méta-analyses montrent une réduction du fardeau total de toxicité et des complications postopératoires, avec une survie globale similaire ou meilleure [12]. Dans les cancers du sein et les tumeurs médiastinales, elle pourrait diminuer les complications cardiaques à long terme [13, 14].
Quel est l’avenir de la protonthérapie ?
Malgré ses avantages dosimétriques, la protonthérapie reste plus coûteuse et moins disponible que la radiothérapie conventionnelle, et son bénéfice clinique par rapport aux photons dépend du type et de la localisation de la tumeur [15].
Ses perspectives de développement sont marquées par plusieurs axes majeursã₤:
- l’optimisation technologique vise à miniaturiser les équipements, notamment par le développement d’installations à faisceau fixe et de salles de traitement plus compactes, ce qui devrait réduire les coûts et faciliter l’implantation. L’amélioration de l’efficacité et de la précision du traitement repose sur l’intensification de l’utilisation du « pencil beam scanning » et de l’ « intensity modulated proton therapy » (IMPT), permettant une modulation plus fine de la dose et une meilleure adaptation aux variations anatomiques et aux mouvements du patient ;
- l’intégration de l’imagerie (imagerie volumique en temps réel, prompt gamma imaging) et le développement de la radiothérapie adaptative sont en cours pour réduire les incertitudes de positionnement et de portée des protons, améliorant ainsi la robustesse des plans de traitement. Par ailleurs, la recherche sur la variabilité de l’efficacité biologique relative (RBE) des protons pourrait permettre une personnalisation accrue des traitements ;
- face à son coût largement supérieur à celui des photons et le rapport coût/efficacité plus favorable de ces derniers, l’augmentation du nombre de sites pourrait permettre une baisse progressive des coûts, favoriser l’innovation technologique et le développement de nouveaux modèles économiques ;
- la validation clinique repose sur la réalisation d’essais randomisés multicentriques et la constitution de registres internationaux pour mieux définir les indications et démontrer le bénéfice clinique et médico-économique dans des populations plus larges.
Après la radiothérapie adaptative et la protonthérapie, quelle est cette nouvelle modalité, la radiothérapie FLASH ?
Actuellement, le temps d’irradiation lors d’une séance de radiothérapie est de plusieurs minutes. Or depuis les premiers travaux in vivo publiés en 2014 [16], le raccourcissement du temps des irradiations à forte dose (> 10 Gy) à quelques millisecondes ou radiothérapie FLASH, soit un débit de 1 000 à 10 000 fois supérieur, semble avoir la même efficacité antitumorale avec un effet protecteur sur les tissus sains (cerveau, poumons) qui développent moins d’effets secondaires.
Les données cliniques restent préliminaires et limitées aux lésions cutanées et aux métastases osseuses [2, 3], mais cela ouvre des perspectives dans le traitement des tumeurs de plus mauvais pronostic et souvent associé à des effets secondaires importants : pancréas, poumon, tumeurs cérébrales, tumeurs de l’enfant.
Les Linac actuels sont-ils capables de délivrer ce type de faisceaux ?
Les Linac actuels délivrent des faisceaux dont le débit est d’environ 1 Gy/s, contre plus de 40 Gy/s pour ces faisceaux de ultra-haut débit dont la production complexe n’est possible qu’à partir de faisceaux d’électrons ou de protons. Le problème de la radiothérapie FLASH réalisée avec des accélérateurs conventionnels est que la cible de tungstène sur laquelle tapent les électrons émis, fond à ce débit de dose.
Concernant les électrons de faible énergie, peu pénétrants, ils ne peuvent traiter que des lésions superficielles [17]. Des essais sont en cours dans les mélanomes et les lymphomes cutanés.
Les faisceaux FLASH développés à partir des protons peuvent traiter des tumeurs profondes. Dans l’essai FAST 01 [18], 10 patients ont été traités pour des métastases osseuses avec un excellent profil de tolérance. L’essai FAST 02 prévoit de prolonger l’évaluation sur des locations osseuses thoraciques (NCT05524064).
En France, deux projets phares s'engagent dans cette voie. Le premier est le projet FRATHEA (Flash Radiation THerapy Electron Acceleration) de l'Institut Curie, qui va développer une technologie électron très haut débit énergie (VHEE pour Very High Energy Electrons) de 100 à 250 MeV contre 10 MeV en conventionnel et permettra le traitement des tumeurs profondes. Les premiers essais cliniques sont prévus à l'horizon 2028.
Le 2e projet est celui de l'Institut Gustave-Roussy qui poursuit le développement à partir des électrons de faible énergie, FLASHKNiFE. Les premiers essais sur les tumeurs superficielles cutanées sont prévus pour 2025.
[1] Yarnold JR, Brunt AM, Chatterjee S, Somaiah N, Kirby AM. From 25 Fractions to Five: How Hypofractionation Has Revolutionised Adjuvant Breast Radiotherapy. Clin Oncol (R Coll Radiol (Great Britain), 2022;34(5):332-339
[2] Chakrabarti D, Green H, Tree A. Hypofractionation/Ultra-Hypofractionation for Prostate Cancer Radiotherapy. Sem Radiat Oncol, 2025;35(3):333-341
[3] Zhong X, Liu Y, Ji Y, Wang L. Thoracic radiotherapy schedules in limited-stage small cell lung cancer: A systematic review and network meta-analysis. Radiother Oncol., 2025 Jun;207:110888
[4] Tsao MN, Ung Y, Cheung P, Poon I, Louie AV. A Systematic Review of Phase II/III Trials of Hypofractionated versus Conventionally Fractionated Radiation Therapy in Stage III Non-Small Cell Lung Cancer Patients. Cancers (Basel), 2024 Oct 3;16(19):3384
[5] Dona Lemus OM, Cao M, Cai B, Cummings M, Zheng D. Adaptive Radiotherapy: Next-Generation Radiotherapy. Cancers, 2024;16(6):1206
[6] Casillas JEJ, Valle LF, Pham J, O'Connell D, Qi XS, Lamb JM, Ghafarian M, Steinberg ML, Cao M, Kishan AU. Advancing Prostate Cancer Treatment: A Review of CT and MR-Guided Online Adaptive Radiotherapy Techniques. Semin Radiat Oncol., 2025 Jul;35(3):342-352
[7] Kishan AU, Ma TM, Lamb JM et al. Magnetic Resonance Imaging–Guided vs Computed Tomography–Guided Stereotactic Body Radiotherapy for Prostate Cancer: The MIRAGE Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol., 2023;9(3):365-373
[8] Daamen LA, Parikh PJ, Hall WA. The Use of MR-Guided Radiation Therapy for Pancreatic Cancer. Semin Radiat Oncol., 2024 Jan;34(1):23-35
[9] Prime S, Schiff JP, Hosni A, Stanescu T, Dawson LA, Henke LE. The Use of MR-Guided Radiation Therapy for Liver Cancer. Semin Radiat Oncol., 2024 Jan;34(1):36-44
[10] Kiss-Miki R, Obeidat M, Máté V et al. Proton or Photon? Comparison of Survival and Toxicity of Two Radiotherapy Modalities Among Pediatric Brain Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. PloS One, 2025;20(2): e-0318194
[11] Vasudevan SS, Deeb H, Katta A et al. Efficacy and Safety of Proton Therapy Versus Intensity-Modulated Radiation Therapy in the Treatment of Head Neck Tumors: A Systematic Review and Meta-Analysis. Head & Neck, 2024;46(10): 2616-2631
[12] Zhou P, Du Y, Zhang Y et al. Efficacy and Safety in Proton Therapy and Photon Therapy for Patients With Esophageal Cancer: A Meta-Analysis. JAMA Netw Open, 2023;6(8): e2328136
[13] Loap P, Beddok A, Cao KI, Goudjil F, Fourquet A, Dendale R, Kirova Y. Clinical practice of breast cancer protontherapy: A single-centre experience from selection to treatment. Cancer Radiother, 2021 Jun;25(4):358-365
[14] Loap P, Goudjil F, Dendale R, Kirova Y. Clinical and technical considerations for mediastinal Hodgkin lymphoma protontherapy based on a single-center early experience. Cancer Radiother, 2021 Dec;25(8):779-785
[15] Howard TP, McClelland S III, Jimenez RB. Evolving Role of Proton Radiation Therapy in Clinical Practice. JCO Oncol Pract, 2024;20(6):771-777.
[16] Favaudon V, Caplier L,Monceau V, Pouzoulet F, Sayarath M, Fouillade C et al. Ultrahigh dose-rate FLASH irradiation increases the differential response between normal and tumor tissue in mice. Sci Transl Med., 2014 Jul 16;6(245):245ra93
[17] Bourhis J, Sozzi WJ, Jorge PG, Gaide O, Bailat C, Duclos F et al. Treatment of a first patient with FLASH-radiotherapy. Radiother Oncol., 2019;139:18-22
[18] Mascia AE, Daugherty EC, Zhang Y, Lee E, Xiao Z, Sertorio M et al. Proton FLASH Radiotherapy for the Treatment of Symptomatic Bone Metastases: The FAST-01 Nonrandomized Trial. JAMA Oncol., 2023 Jan 1;9(1):62-69

 17 minutes
17 minutes Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire.jpg)



Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.