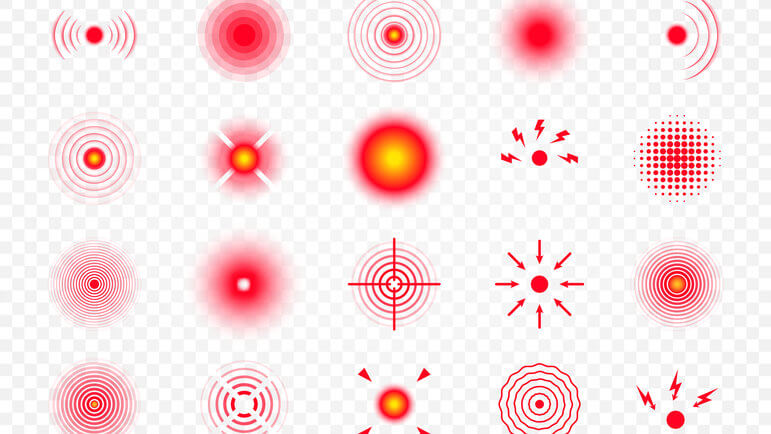
Une pathologie reconnue par l'OMS. Yevhenii Dubinko / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
La fibromyalgie est due à une perturbation du système de contrôle central de la douleur à l’origine d’une hypersensibilité à la douleur. Elle est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui la classe parmi les douleurs chroniques généralisées. Sa prévalence est de 1,5 % à 2 % en population générale, atteignant plus souvent les femmes.
Afin de clarifier la démarche diagnostique et thérapeutique, la Haute Autorité de santé (HAS) a récemment publié une recommandation de bonne pratique [1] assortie d’une fiche à destination des patients [2].
En l’absence de marqueurs spécifiques, le diagnostic repose sur la clinique, un bilan biologique minimal ayant pour objectif essentiel de rechercher d’autres pathologies douloureuses ou des maladies concomitantes.
L’activité physique a un rôle thérapeutique majeur qu’il faut encourager, de même que l’autogestion de la maladie. Les bénéfices du traitement médicamenteux à visée antalgique sont en revanche modestes. Une attention particulière doit être portée au risque de mésusage des opioïdes dont l’utilisation doit rester exceptionnelle.
Tour d’horizon avec Dr Didier Bouhassira, directeur de l’unité Inserm physiopathologie et pharmacologie de la douleur, centre d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt.
Longtemps considérée comme une curiosité médicale, voire une maladie imaginaire, la fibromyalgie est aujourd’hui reconnue comme une pathologie authentique, classée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) parmi les douleurs chroniques généralisées. Concernant de 1,5 % à 2 % de la population, elle est trois fois plus fréquente chez les femmes.
La fibromyalgie est caractérisée par une perturbation des processus de contrôle de la douleur au niveau du système nerveux central, avec une exacerbation des systèmes facilitateurs et une baisse des systèmes de contrôle inhibiteurs. Ces phénomènes sont à l’origine d’une hypersensibilisation généralisée à la douleur, et même, d’une hypersensibilité tout court (visuelle, auditive…). À cet égard, elle entre dans le groupe des douleurs nociplastiques (classe différente de celle des douleurs nociceptives et neuropathiques), tout comme d’autres affections plus localisées comme le syndrome de l’intestin irritable, certaines céphalées chroniques, douleurs pelviennes chroniques, stomatodynies…
Des facteurs de risque suspectés
Des antécédents d’événements traumatiques sont un peu plus souvent rapportés dans la fibromyalgie, comme dans toutes les populations souffrant de douleurs chroniques, mais c’est surtout les stress chroniques qui semblent jouer un rôle dans son apparition chez certains individus, qu’ils soient psychologiques ou somatiques.
Ainsi, dans la polyarthrite rhumatoïde, l’état inflammatoire chronique peut provoquer une surstimulation des voies de la douleur à l’origine d’une fibromyalgie secondaire. Et même après la rémission du rhumatisme grâce aux traitements immunomodulateurs, la sensibilisation centrale peut perdurer et la douleur fibromyalgique s’autonomiser.
Un diagnostic uniquement clinique
Si les preuves de cette implication neurologique centrale ont été apportées par la neuro-imagerie fonctionnelle et les explorations électrophysiologiques, son dépistage et son diagnostic reposent uniquement sur la clinique, en l’absence de marqueurs spécifiques [1].
Il faut donc savoir l’évoquer devant des douleurs persistantes évoluant depuis plus de trois mois, diffuses, mais fluctuantes dans le temps et aussi en intensité ou en localisation. Peuvent s’y adjoindre d’autres symptômes tels la fatigue, des troubles du transit, une dépression…
En soins primaires, l’autoquestionnaire FIRST (Fibromyalgia Rapid Screening Tool) est un outil de dépistage simple et très utile, mais seuls l’examen et l’appréciation cliniques autorisent le diagnostic.
Le bilan biologique est normal et il n’existe aucune maladie ni prise médicamenteuse pouvant expliquer les douleurs. Néanmoins, certaines pathologies, notamment inflammatoires douloureuses (voir plus haut), peuvent aussi faire le lit de la fibromyalgie. Il faut donc à la fois écarter les diagnostics différentiels devant des résultats anormaux, mais aussi avoir à l’esprit la possibilité de sa concomitance avec d’autres affections.
La confirmation du diagnostic peut s’appuyer sur les critères de l’American College of Rheumatology (révisés en 2016).
Il reste alors à évaluer son retentissement dans la vie quotidienne, familiale et professionnelle, rechercher son impact notamment anxiodépressif.
L’activité physique avant tout
En l’absence de traitement spécifique, la prise en charge, initiée et coordonnée par le médecin traitant, qui joue là un rôle fondamental, va être coconstruite par le praticien et le patient. En préambule, il est essentiel que ce dernier comprenne bien ce qu’est sa maladie et son traitement (cf. Fiche patient de la Haute Autorité de santé [HAS] [2].
La stratégie thérapeutique s’appuie principalement sur l’activité physique qui est fondamentale [1]. Celle-ci a un objectif fonctionnel, via une remobilisation progressive et adaptée à l’état clinique du patient, sachant que, dans certains cas, la fibromyalgie peut être responsable d’une incapacité physique majeure. Mais la remise en mouvement a également un effet antalgique en agissant sur le système de contrôle de la douleur.
Il est capital d’insister sur son intérêt et de convaincre les patients des bénéfices d’une telle approche, qui peut sembler contre-intuitive. Ce, d’autant que la douleur entraînant une limitation des mouvements, cette dernière favorise la persistance des douleurs. C’est aussi pour rompre ce cercle vicieux qu’un réapprentissage à l’effort est essentiel.
À noter que, a contrario, il existe une frange de patients qui sont hyperactifs ce qui peut tout autant être délétère.
Un simple encouragement à un sport régulier, l’adressage vers un kinésithérapeute peuvent parfois suffire. Dans d’autres cas, un programme d’éducation physique adaptée (APA), voire l’orientation vers un professionnel de la réadaptation est nécessaire. L’objectif est avant tout d’augmenter la qualité de vie et de favoriser la reprise de l’activité.
Un autre axe est celui de l’autogestion de la maladie, par exemple par l’apprentissage d’une simplification et d’un fractionnement des activités quotidiennes, alternant avec des plages de repos. L’éducation thérapeutique est dans ce cadre un atout pour renforcer l’autonomie du patient, tout comme parfois une intervention psychologique destinée, par exemple, à agir sur les attitudes d’évitements ou des pensées erronées.
La prise en charge des problèmes de santé associés ne doit pas être oubliée (troubles du sommeil, dépression, surpoids). Le maintien de l’emploi est également une priorité, ce qui peut réclamer l’appui du médecin du travail.
Les bénéfices du traitement médicamenteux sont en revanche très modestes. Dans tous les cas, une augmentation progressive de la posologie est également de mise pour limiter l’apparition d’effets indésirables.
Les douleurs ponctuelles peuvent réclamer la prescription de paracétamol ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais jamais au long cours. En présence de douleurs continues, il peut ainsi être fait appel à certains antidépresseurs ou à certains antiépileptiques.
Quant au tramadol et autres opioïdes, leur usage doit rester exceptionnel pour éviter mésusage et risques inhérents.
D’autres interventions peuvent aussi entrer dans le cadre du projet de soins : cures thermales, relaxation, hypnose…
En dernier recours, les centres antidouleur peuvent proposer des techniques comme la neurostimulation électrique transcutanée (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation [TENS]) pour des douleurs localisées ou bien, pour un effet plus général, la stimulation magnétique transcrânienne répétée (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation [rTMS]) ou la stimulation transcrânienne à courant continu (Transcranial Direct Current Stimulation [tDCS]).
D’après un entretien avec le Dr Didier Bouhassira, directeur de l’unité Inserm physiopathologie et pharmacologie de la douleur, centre d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt.
[1]
[2]

 6 minutes
6 minutes Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire







Les commentaires sont momentanément désactivés
La publication de commentaires est momentanément indisponible.