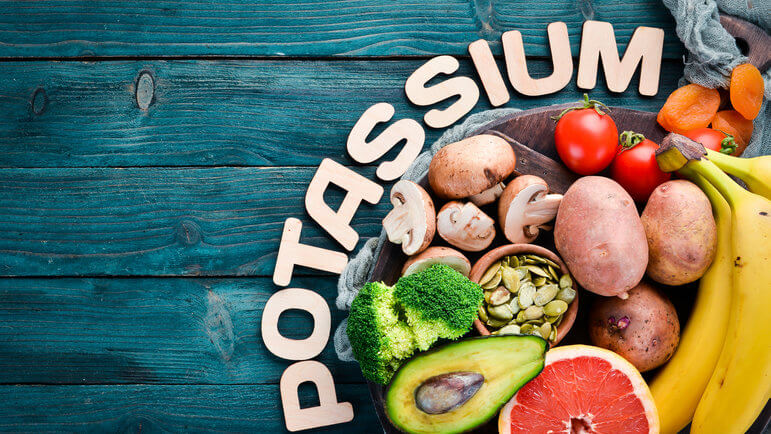
Les légumes verts ont généralement un bon ratio apport potassique/apport calorique. Nataliia Mysak / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Parmi les mesures hygiéno-diététiques qui permettent de diminuer la pression artérielle, l’importance de l’augmentation des apports alimentaires de potassium a longtemps été négligée, alors qu’elle est au moins aussi efficace que la diminution de la consommation de sel, très largement recommandée. Le potassium peut être apporté par une alimentation riche en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes et fruits à coque (donc de type méditerranéen) ou encore par des sels dits « de régime » dans lesquels environ 25 à 30 % du sel de sodium est remplacé par du sel de potassium. À la suite d'études récentes de grande ampleur ayant démontré leur efficacité sur le risque cardiovasculaire, l’utilisation de ces sels enrichis en potassium est à présent recommandée par les sociétés savantes, mais il convient de rester prudent chez les patients à risque d’hyperkaliémie, au premier rang desquels les insuffisants rénaux.
CE QUE NOUS FAISONS
L’hypertension artérielle (HTA) est définie par une pression artérielle (PA) systolique ≥ 140 mm Hg et/ou une PA diastolique ≥ 90 mm Hg. Dans le monde, 1,28 milliard d’adultes sont hypertendus et 9 millions de décès sont causés par l’HTA chaque année : il s’agit du premier facteur de risque modifiable de mortalité1. En France, l’HTA est la maladie chronique la plus fréquente, elle concerne environ 17 millions d’adultes, et le contrôle tensionnel a une nette tendance à se dégrader ces dernières années ; actuellement seul un hypertendu sur quatre est contrôlé2.
S’il est important de détecter l’HTA le plus précocement possible et de la traiter par des mesures pharmacologiques efficaces pour atteindre un objectif optimal, inférieur à 130/80 mm Hg dans la plupart des cas3, la diffusion et l’implémentation à large échelle des mesures hygiéno-diététiques qui permettent de retarder l’apparition d’une HTA et qui complètent le traitement médicamenteux sont tout aussi importantes et trop souvent négligées.
De nombreuses mesures non pharmacologiques, reposant sur une meilleure hygiène de vie, permettent de retarder l’apparition d’une HTA et de baisser la PA chez les hypertendus. Le sevrage tabagique est toujours indiqué, mais dans une optique de prévention cardiovasculaire plus que pour un effet tensionnel. Parmi les mesures efficaces sur la PA, les principales consistent à perdre du poids, pratiquer une activité physique régulière, limiter la consommation d'alcool et d'aliments salés4. Si l’impact bénéfique d’une alimentation moins salée est bien connu des soignants et du grand public, cette mesure est relativement peu suivie. Le dernier état des lieux de Santé publique France montre que 90 % des hommes et 70 % des femmes mangent plus de 6 g de sel par jour5.
Une recommandation nutritionnelle au moins aussi efficace, mais nettement moins connue que la diminution du sel, consiste à augmenter les apports en potassium. Les aliments riches en potassium sont notamment les fruits, les légumes, les légumineuses (également appelés légumes secs comme les lentilles et les pois chiches), les céréales complètes et les fruits à coque (amandes, noix…). La consommation de ces aliments riches en potassium, largement recommandés dans le cadre d’une alimentation équilibrée (sous réserve de limiter la quantité des plus caloriques d’entre eux) telle que préconisée par le dernier Programme national nutrition santé 2019-20236, reste également loin des objectifs. À titre d’exemple, seuls 42 % des adultes et 23 % des enfants mangent au moins 5 fruits et/ou légumes par jour5. Une étude récente a rapporté que l'apport de potassium dans le monde est en moyenne de 58 mmoles (2,3 g) par jour, la consommation étant la plus faible en Asie et la plus élevée en Europe de l’Ouest7. Il y est estimé que la consommation de potassium en France était de 82 mmoles (3,2 g) par jour, mais les données provenaient en majorité de questionnaires alimentaires. Ce chiffre est probablement surestimé, car la kaliurèse moyenne chez 50 candidats au don de rein (par définition en bonne santé) évalués entre 2022 et 2024 dans un service de physiologie (hôpital Bichat, Paris, données personnelles non publiées) était de 59 ± 20 mmoles par jour, soit 2,3 g de potassium. Même si l’on tient compte du fait que la kaliurèse correspond à environ 90 % des apports alimentaires, ces derniers sont donc assez nettement inférieurs au seuil minimal de 90 mmoles (3,5 g) par jour recommandé par la plupart des sociétés savantes4.
Des résultats récents ont remis au premier plan l’importance de la consommation de potassium sur la santé cardiovasculaire.
CE QUI CHANGE
Une étude publiée en 2021 dans le New England Journal of Medicine a confirmé l’importance de la consommation du potassium sur la PA et démontré son bénéfice sur les événements cardiovasculaires8. Cette grande étude appelée SSaSS (Salt Substitute and Stroke Study) a été conduite en Chine chez 20 995 participants recrutés dans 600 villages entre 2014 et 2015. Ces villages étaient tirés au sort, et, dans 300 d’entre eux, le sel de table et de cuisine était remplacé par un sel dit de régime ou substitut de sel (salt substitute), dans lequel 25 % du NaCl était substitué par du KCl. Pour être inclus, les sujets devaient être hypertendus et, par ailleurs, soit âgés de plus de 60 ans, soit avoir un antécédent d’accident vasculaire cérébral (AVC). Étaient exclus les patients sous suppléments potassiques ou diurétiques épargneurs de potassium et les insuffisants rénaux sévères. Après un suivi de près de 5 ans, les résultats ont été spectaculaires : le taux d’AVC était réduit significativement, de 14 %, celui des événements cardiovasculaires de 13 % et la mortalité de 12 % dans les villages qui recevaient le sel enrichi en potassium. Cet effet était attribué par les auteurs à une diminution de PA systolique, de 3,34 mm Hg. En effet, cette baisse tensionnelle, bien que modeste en apparence, n’est pas négligeable, car il faut savoir qu’une diminution de PA systolique de 10 mm Hg permet de réduire le risque d’AVC d’environ 35 %. Des analyses urinaires dans un sous-groupe de participants ont conduit à supposer que les bénéfices de l’intervention étaient plus vraisemblablement attribuables à l’augmentation des apports potassiques (qui sont passés de 36 à 57 mmoles par jour, soit 58 % d’augmentation) qu’à la diminution des apports sodés (qui sont passés de 187 à 172 mmoles par jour, soit 8,1 % de réduction). Notons que le choix de la Chine pour conduire cette étude (dont le financement était australien) n’était pas anodin, car les apports sodés moyens y sont très élevés et inversement pour les apports potassiques ; en outre, le sel consommé provient quasi exclusivement du sel de cuisine et de table, contrairement à des pays dont l’alimentation est ultra-transformée, déjà salée par l’industrie agro-alimentaire, dans lesquels l’utilisation d’un sel modifié au domicile aurait un impact minimal sur la consommation réelle de sel.
L’impact scientifique de cette étude a été majeur puisqu’elle a apporté la première démonstration du bénéfice d’une modification des apports sodés et potassiques sur les événements cardiovasculaires, et confirmé un effet sur la diminution de la PA. Elle a conduit à remettre au premier plan l’intérêt de l’augmentation des apports de potassium pour la santé cardiovasculaire. Le bénéfice tensionnel d’une alimentation riche en potassium avait pourtant déjà été montré par un grand nombre d’études depuis une quarantaine d’années, aussi bien par des modifications de régime (exemple étude DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension), que par des apports de potassium sous forme de compléments, ou enfin par des substituts de sel enrichis en potassium comme dans l’étude SSaSS. Les méta-analyses de ces études interventionnelles sont également nombreuses et solides, et permettent de quantifier que, lorsque la supplémentation potassique permet d’atteindre des apports de 90 à 120 mmoles par jour, la réduction de PA systolique est de l’ordre de 7 mm Hg9. Le bénéfice de l’augmentation des apports potassiques est d’autant plus marqué que les sujets sont hypertendus et qu’ils consomment plus de sel.
CE QUE NOUS FERONS
L’HTA en France constitue un fléau dont le contrôle se dégrade. L’implémentation large et précoce de modifications d’hygiène de vie en général, et nutritionnelles en particulier, reposant notamment sur des initiatives de santé publique nationales, fait partie des actions à mener pour diminuer la prévalence de la maladie et améliorer son contrôle.
L’importance de ces mesures hygiéno-diététiques est mise en lumière par les dernières recommandations 2024 de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui ont révisé en profondeur la classification de la PA3. Si l’HTA est toujours définie par une PA ≥ 140/90 mm Hg, les auteurs ont introduit une nouvelle catégorie, la PA élevée, qui concerne les individus dont la PA systolique est entre 120 et 139 mm Hg et/ou la PA diastolique est entre 70 et 89 mm Hg. Cette nouvelle catégorie est notamment destinée à identifier précocement une PA qui n’est pas strictement normale et mettre en place des mesures préventives pour diminuer l’évolution vers une HTA. Il a été estimé que plus de la moitié (53 %) de la population française adulte répond à cette définition de PA dite « élevée »10. Or pour cette très large catégorie de sujets, les recommandations indiquent un traitement non pharmacologique, dont l’augmentation des apports en potassium. Si la PA est ≥ 130/80 mm Hg après 3 mois et que le risque cardiovasculaire est élevé, il convient alors d’introduire un traitement pharmacologique en complément3. Notons que pour les toutes récentes recommandations américaines, en cas de PA ≥ 130/80 mm Hg, le traitement pharmacologique vient compléter les modifications hygiénodiététiques d’emblée en cas de risque élevé et après 3 à 6 mois en cas de risque faible à modéré11. Il va sans dire que ces interventions diététiques s’appliquent également à tous les hypertendus (environ 30 % de la population adulte en France) en complément des mesures pharmacologiques.
S’il convient d’insister encore et toujours sur l’importance de l’activité physique, d’une perte de poids, d’une consommation idéalement nulle d’alcool, d’une bonne hygiène de vie incluant la qualité de sommeil et la baisse de la consommation sodée, une alimentation globalement équilibrée et riche en potassium de style méditerranéen, en accord avec le dernier Programme national nutrition santé (PNNS) 2019-20236, doit être largement conseillée (cf. Encadré). L’apport calorique, parmi les aliments riches en potassium, est très variable et il faut savoir en tenir compte dans les quantités d’aliments ingérés. Ainsi les fruits à coque comme les amandes sont riches en minéraux dont le potassium, mais également très caloriques, d’où la recommandation d’une « petite poignée » quotidienne. À l’opposé, les légumes verts ont généralement un bon ratio apport potassique/apport calorique et peuvent être consommés sans limitation, le plus riche en potassium étant l’épinard. Notons à cet égard que parmi les féculents, la pomme de terre a un ratio potassium/calories nettement plus favorable (5 à 10 fois supérieur) que les pâtes ou le riz et peut avantageusement les remplacer (Tableau 1).
Dans une mise au point sur les liens entre nutrition et HTA publiée fin 20244, la Société française d'hypertension artérielle (SFHTA) recommande « des apports alimentaires en potassium d’au moins 3,5 g (90 mmoles) par jour. Les apports quotidiens en potassium s’évaluent au mieux par la kaliurèse ; il faut savoir que 1 g de K correspond à 26 mmoles de K. Dans l’idéal, cet objectif doit être atteint en priorisant l’augmentation des apports en potassium à partir de l’alimentation. En effet, les régimes riches en potassium ont des bénéfices cardiovasculaires qui dépassent le seul bénéfice tensionnel et il s’agit de l’intervention la moins à risque d’entraîner une hyperkaliémie ». En France, les apports potassiques sont en moyenne de 10 à 30 mmoles inférieurs aux apports recommandés selon les estimations et les objectifs peuvent donc raisonnablement être atteints par des modifications alimentaires.
Les sels de régime, sous réserve d’un usage prudent dans certaines populations à risque d’hyperkaliémie, peuvent s’avérer un complément utile et facile à implémenter pour augmenter les apports potassiques tout en limitant les apports sodés. Leur utilisation, notamment chez les patients qui consomment beaucoup de sel, est à présent explicitement recommandée, avec un niveau de preuve élevé (qui fait suite à l’étude SSaSS) par les dernières recommandations européennes (2024)3 et américaines (2025)11. Leur usage est discuté en détail dans un document dédié publié en 2024 par la SFHTA12, qui a cependant explicitement incité à la prudence chez certains patients : « L’utilisation de ces sels enrichis en potassium doit être cependant prudente chez les patients à risque d’hyperkaliémie (médicaments hyperkaliémiants, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale modérée, diabète, personnes âgées notamment) et déconseillée chez ceux ayant une insuffisance rénale chronique sévère (DFG < 30 mL/min/1,73 m²). Ainsi, il est préférable de valider la décision d’utiliser régulièrement un sel de substitution avec son médecin traitant quand on est traité pour une HTA dont le traitement comporte très souvent des médicaments pouvant augmenter la kaliémie (IEC, ARAII, spironolactone…) ». L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a également alerté récemment sur les risques associés à une consommation non contrôlée de sels potassiques utilisés en substitution au sel de table (cf. article du Vidal du 5 juin 2025). En particulier, elle recommande pour les personnes à risque d'hyperkaliémie (insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux, hypertendus, diabétiques et sujets âgés...), à l’instar de SFHTA, une consommation sous contrôle médical.
En pratique, il convient d’avoir un ionogramme sanguin et une créatininémie avec estimation de la fonction rénale récents avant de conseiller l’usage de ces substituts de sel. Chez un sujet dont la fonction rénale est normale et qui n’a pas de médicaments interférant avec l’homéostasie du potassium, les variations de kaliémie en fonction des apports potassiques sont minimes. En revanche, une telle supplémentation potassique est déconseillée chez les patients avec une insuffisance rénale stade 4 et 5 (donc ayant un débit de filtration glomérulaire < 30 mL/min/1,73 m²), chez les patients qui ont spontanément une kaliémie supérieure à la norme du laboratoire, et chez les patients qui reçoivent des médicaments hyperkaliémiants et ont une kaliémie dans les valeurs hautes de la normale (il est difficile de donner une valeur exacte, un seuil de 4,5 mmol/L peut être donné à titre indicatif selon le nombre de médicaments associés).
Il convient de bien rechercher la prise de tels médicaments, les plus fréquents étant tous les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (donc les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 et les antagonistes de l’aldostérone), l’amiloride, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le cotrimoxazole.
Dans ces situations, l'ionogramme peut être surveillé dans le mois qui suit l’introduction des suppléments et en cas de situation à risque de déshydratation, sachant qu’il est par ailleurs surveillé tous les 6 à 12 mois chez les patients hypertendus traités par diurétiques et/ou inhibiteurs du système rénine-angiotensine.
Ce que nous faisons : En France comme dans le monde, les apports alimentaires de potassium sont inférieurs aux apports recommandés.
Ce qui change : Le bénéfice d’une augmentation des apports potassiques sur la baisse de PA et la prévention des événements cardiovasculaires (notamment les AVC) est à présent solidement démontré. Les interventions nutritionnelles pour prévenir l’HTA sont désormais conseillées dès que la PA est ≥ 120/70 mm Hg.
Ce que nous ferons : Il convient, aussi bien par des approches individuelles que de santé publique, de prescrire une alimentation équilibrée incluant des apports suffisants en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes et fruits à coque qui sont particulièrement riches en potassium. Les sels de substitution (25 à 30 % du NaCl y est remplacé par du KCl) peuvent aider également, mais sont à éviter chez les sujets à risque d’hyperkaliémie.
|
RECOMMANDATIONS POUR AUGMENTER LES APPORTS EN POTASSIUM AU SEIN D’UNE ALIMENTATION GLOBALEMENT ÉQUILIBRÉE Il convient de consommer, en moyenne :
Rappelons que de manière générale, les aliments transformés ou ultra-transformés sont pauvres en potassium et en fibres, souvent riches en sel, sucre et acides gras saturés, et sont à éviter. Les cuissons vapeur, en autocuiseur, au micro-ondes, à l’étouffée ou au four limitent la perte potassique dans l’eau de cuisson. Ces conseils font partie des recommandations du dernier PNNS (2019-2023) et s’intègrent dans une alimentation de type méditerranéenne – pour les Européens, les Américains se référant quant à eux au régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension [combattre l’hypertension par l’alimentation]) qui est très proche – qui inclut également certains poissons gras (sardines, saumon…) et limite la viande rouge et les produits laitiers les plus gras (fromage, beurre, crème…). Pour plus de détails, voir le texte complet du PNNS6 et pour des conseils adaptés au grand public, voir le site mangerbouger.fr
|

Pr Emmanuelle Vidal-Petiot, MD, PhD
PU-PH, Service de Physiologie, Centre d’excellence européen en hypertension artérielle, Hôpital Bichat, 75018 Paris
emmanuelle.vidal-petiot@aphp.fr
L'auteur déclare les liens d'intérêts suivants : financement de congrès par Servier. Rémunérations ponctuelles pour des conférences par AstraZeneca et par Servier.
1 - Global report on hypertension: the race against a silent killer. World Health, Organization. Genève, 2023.
2 - Olié V, Grave C, Gabet A, Chatignoux E, Gautier A, Bonaldi C et coll. Épidémiologie de l’hypertension artérielle en France : prévalence élevée et manque de sensibilisation de la population. Bull Épidémiol Hebd. 2023; (8): 130–8.
3 - McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, Ceconi C et coll. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. European Heart Journal. 2024; 45: 3912–4018.
4 - Bely H, Tordjmann E, Rivière J, Blacher J, Fauvel J-P, Vidal-Petiot E. Mise au point de la SFHTA. Nutrition et Hypertension Artérielle. Paris: SFHTA, 2025.
5 - Équipe de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle (Esen). Étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition (Esteban), 2014-2016. Volet Nutrition. Chapitre Consommations alimentaires. Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. 193 p. https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/etude-de-sante-sur-l-environnement-la-biosurveillance-l-activitephysique-et-la-nutrition-esteban-2014-2016-chapitre-consommations-alimentair
6 - Programme national nutrition santé 2019-2023. 2019.
7 - Reddin C, Ferguson J, Murphy R, Clarke A, Judge C, Griffith V et coll. Global mean potassium intake: a systematic review and Bayesian meta-analysis. Eur J Nutr. 2023; 62: 2027–2037.
8 - Neal B, Wu Y, Feng X, Zhang R, Zhang Y, Shi J et coll. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. N Engl J Med. 2021; 385: 1067–1077.
9 - Granal M, Sourd V, Burnier M, Fauvel JP, Gougeon A. Effect of changes in potassium intake on blood pressure: a dose-response meta-analysis of randomized clinical trials (2000-2024). Clin Kidney J. 2025; 18: sfaf173.
10 - Vidal-Petiot E, Kab S, Steg PG. New Definition of Elevated Blood Pressure in the 2024 ESC Guidelines: Increased Prevalence, Uncertain Evidence. Circulation. 2025; 151: 518–520.
11 - Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, Johnson HM, Shimbo D, Abdalla M et coll. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2025: S0735-1097(25)06480–0.
12 - Bejan-Angoulvant T, Duly-Bouhanick B. Apports de potassium chez le patient hypertendu : recommandations internationales et prise de position de la SFHTA. Paris: SFHTA, 2024.

 14 minutes
14 minutes 1 commentaire
1 commentaire 







A Chaque fois que nous observons, plus les études progressent, plus l'importance d'une alimentation saine est la base du traitement .
Vous venez de signaler ce commentaire. Confirmez-vous votre choix?