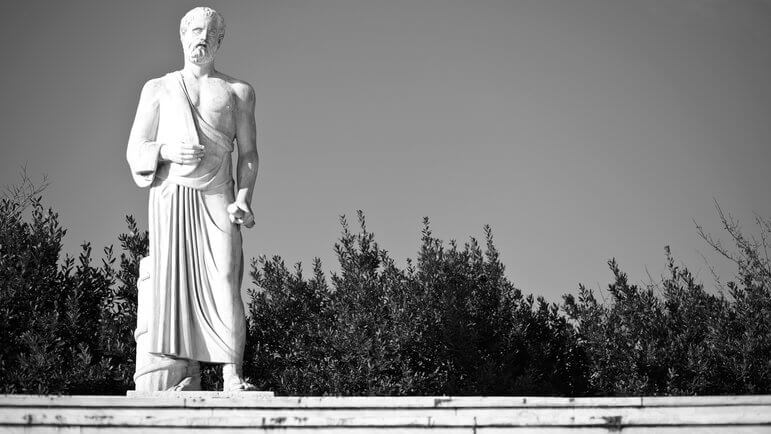
Hippocrate faisait partie des familles de médecins de la Grèce antique, les AsclépiadesYoeml / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Le serment d’Hippocrate est un texte symbolique lu par certains professionnels de santé lors de la remise de diplôme. Sans valeur juridique, il conserve néanmoins une forte portée symbolique, morale et éthique.
S’il a pu évoluer au cours des 25 siècles de son existence, ses principes constants sont la probité, le respect des patients, la confidentialité, la non-nuisance et la transmission du savoir. Certains éléments anciens ont disparu des versions modernes, remplacés par des nouveaux en lien avec l’éthique et les droits de l’homme.
En Occident, son intégration aux études médicales s’est faite progressivement à partir de la Renaissance. En 1948, un texte universel, la Déclaration de Genève, a été proposé par l’Association médicale mondiale. En France, le Conseil national de l’ordre des médecins a publié en 2012 une nouvelle version adaptée aux enjeux contemporains.
Aujourd’hui, chaque université choisit sa propre variante, mais partout le serment reste une boussole pour l’impétrant.
Le serment d’Hippocrate est un texte solennel lu par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes au moment de la délivrance de leur diplôme. Bien qu’il n’ait pas de valeur juridique (à l’inverse des codes de déontologie qui reprennent certains de ses principes), il marque symboliquement l’entrée dans la profession médicale et demeure une référence morale et éthique.
Pourtant, il serait naïf de penser que le texte lu aujourd’hui (ou plutôt les textes, comme nous le verrons) est celui écrit il y a 25 siècles. Quasiment ignoré pendant un millénaire, il a depuis évolué, en particulier au cours de la seconde moitié du XXe siècle, pour s’adapter aux changements sociétaux et médicaux. Il nous a semblé intéressant de raconter l’histoire de ce symbole et de son utilisation dans la cérémonie de remise de diplôme.
Les origines du serment dit d’Hippocrate
Le serment d’Hippocrate fait partie des textes dits de la Collection hippocratique [1]. Ce corpus a été rédigé par plusieurs auteurs, dont Hippocrate, probablement entre 440 et 360 av. J.-C. Dans la Grèce antique, coexistaient des prêtres-guérisseurs, des rebouteux, mais aussi des familles spécialisées dans le soin, les Asclépiades, dont le savoir était transmis au sein du giron familial. Hippocrate faisait partie de celles-ci.
Confrontées à une raréfaction de ses membres, les Asclépiades ouvrirent leur enseignement à des personnes étrangères et durent à la fois formaliser leurs savoirs et créer un contrat liant l’apprenti au maître édictant des principes intangibles, pour éviter que ces disciples ne ternissent la réputation familiale [2]. La teneur du serment s’inscrit dans ce contexte.
Une structure et des éléments stables depuis 25 siècles
Malgré son évolution au cours du temps, les principes du serment sont structurés de façon constante :
- une invocation de ceux devant qui l’apprenti s’engage : dieu(x), être suprême, maîtres, condisciples, effigie d’Hippocrate, etc. ;
- un engagement déontologique envers les patients et la promesse de ne pas refuser de soins aux patients indigents ;
- la promesse de ne pas nuire, ni d'être injuste ;
- le devoir de discrétion et de confidentialité, et l’absence de relations amorales avec le ou la patiente et son entourage ;
- le respect des maîtres et l’engagement de transmission du savoir médical aux générations suivantes ;
- la conscience de n’être plus digne de respect si ces principes étaient bafoués.
Parmi les éléments du serment historique qui ont été écartés dans les versions les plus récentes, on peut signaler :
- l’obligation de subvenir aux besoins matériels de son maître, si nécessaire ;
- l’interdiction de donner un « poison » ou d’aider un autre à le faire ;
- l’interdiction d’administrer un pessaire contraceptif ou abortif (à l’époque, un tampon de laine imprégné de diverses substances, inséré dans le vagin) ;
- l’interdiction de pratiquer l’ablation des calculs de la vessie (« opération de la taille », à laisser aux professionnels de la chose).
Une évolution dans l’espace et dans le temps
Retracer de manière détaillée la façon dont le serment a voyagé dans le temps et l’espace dépasse les limites de cet article. Pour résumer, le serment hippocratique a été source d’inspiration pour d’autres textes historiques relatifs à la déontologie médicale :
- dans l’antiquité romaine, bien que la collection hippocratique soit fondamentale à la médecine romaine, la responsabilité du médecin était plutôt déterminée par une loi relative aux homicides (la loi Cornelia datant de 81 av. J.-C.) [2] qui interdisait le poison, les médicaments abortifs, les médicaments dangereux ou la « castration par luxure ou par profit » ;
- dans le monde juif, le serment d’Assaf (IIIe-Ve siècles) [3] le reprend et il a également inspiré le serment dit « de Maïmonide » (écrit à la fin du XVIIIe siècle, probablement par un médecin allemand) [4] ;
- dans le monde musulman : au IXe siècle, on retrouve des traités d’éthique médicale (par exemple, les « règles du médecin » (Adab al-Tabib) d’Ishaq ibn al-Ruhawi) [5] qui s’inspirent d’Hippocrate et essaient de concilier éthique médicale et règles de l’islam.
L’intégration du serment d’Hippocrate dans les études médicales en Occident
Dans le monde chrétien, des textes visant à lier les étudiants à leurs maîtres et à leur université médicale existent dès le XIIIe siècle (dès 1220 à l’université de Montpellier), sans référence hippocratique [2]. Les premières traces de documents de ce type puisant nommément dans les principes d’Hippocrate datent du XVIe siècle, en Allemagne (université de Wittenberg, 1508). En 1558, dans les universités de Heidelberg et de Iéna, le serment d’Hippocrate proprement dit est mentionné pour la première fois dans les études médicales en Occident. Il n’est pas lu formellement au cours d’une cérémonie, mais signalé comme référence à suivre.
La première utilisation du texte hippocratique comme « promesse » à lire par les nouveaux diplômés a lieu en 1804 à l’université de Montpellier dans le cadre du « Cérémonial pour les examens et la réception des docteurs » [2]. Le terme « serment » apparaîtra dans les années suivantes (mais pas celui de « serment d’Hippocrate », plus tardif). Pendant plus d’un siècle, seule l’université de Montpellier exigera cette lecture : les autres universités françaises n'adopteront cette pratique qu’entre les deux guerres mondiales [2].
1948 : une version universelle proposée par l’Association médicale mondiale
En 1948, l’Association médicale mondiale, fondée en 1947, adopte la Déclaration de Genève [6], version contemporaine du serment, régulièrement amendée depuis pour intégrer les changements sociétaux. Ce texte, utilisé lors de la remise du diplôme dans certains pays, en particulier en Afrique et en Asie, présente des particularités intéressantes absentes du serment traditionnel :
- il interdit au médecin d’« utiliser (ses) connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte », direct héritage du procès de Nuremberg ;
- il interdit que « des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation politique, de race, d’orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur » nuisent à la qualité de la prise en soin ;
- il conseille au médecin de veiller « à (sa) propre santé, à (son) bien-être et au maintien de (sa) formation afin de prodiguer des soins irréprochables ».
2012 : le Conseil national de l’ordre des médecins propose une nouvelle version française
En France, la version du serment proposée par le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) en 2012 [7] intègre, elle aussi, des éléments qui ne sont présents ni dans le serment historique, ni dans la Déclaration de Genève :
- elle est harmonisée avec la définition de la santé donnée par l’Organisation mondiale de la santé (physique, mentale, individuelle et sociétale) ;
- elle insiste sur la nécessité d’informer clairement le patient sur les décisions envisagées, le patient conservant « son autonomie et sa volonté » ;
- elle met en garde contre la prolongation abusive de l’agonie, mais s’oppose à donner la mort délibérément ;
- elle souligne la nécessité de l’indépendance des médecins vis-à-vis des influences extérieures.
Dans ce texte, la prise à témoin du divin ou des maîtres est supprimée, l’impétrant jurant « d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité ».
En pratique, en France, des variations régionales selon les universités
En 2015, 17 versions du serment étaient employées en France. La moitié des facultés utilisait une version adaptée du serment historique et un tiers celle du Cnom [8]. Chaque faculté peut décider de la version qu’elle propose lors des cérémonies, le serment n’ayant qu’une valeur symbolique.
Plusieurs raisons expliquent cette diversité :
- des raisons historiques locales : certaines universités conservent la version à laquelle elles sont particulièrement attachées (par exemple, Montpellier), ou optent pour un texte raccourci (voir par exemple celle de Santé Sorbonne Université, particulièrement laconique) [9] ;
- le rapport à la laïcité : selon la sensibilité locale, des références religieuses peuvent persister (l’université de Strasbourg propose deux documents, dont l’un évoque « l’Être Suprême » [10], également utilisé en Franche-Comté) [11] ;
- la sensibilité de la faculté locale aux questions légales, éthiques et sociétales, avec une volonté d'évoquer les enjeux contemporains, mieux mis en avant dans la version actuelle du Cnom ;
- l’inertie concernant la mise à jour de la cérémonie de remise de diplôme.
Et dans les autres pays ?
La plupart des pays ont adopté le principe, pour les médecins impétrants, de la lecture d’un document mettant en avant leurs obligations morales et éthiques, mais peu ont recours au serment d’Hippocrate, qu’il soit historique ou moderne. Dans les pays qui n’utilisent ni le texte hippocratique, ni la Déclaration de Genève, il s’agit en général d’un texte propre à chaque université, rédigé à partir de ces deux sources et du code de déontologie local, mais qui reçoit néanmoins l’appellation de « serment » pour mettre en valeur son aspect symbolique et moral, au sein d’une cérémonie formelle.
Conclusion
Le serment d’Hippocrate, bien qu’ayant un peu perdu de sa forme originelle et n’ayant aucune valeur juridique, demeure un repère moral et symbolique qui marque, pour les soignants, l’entrée dans la vie professionnelle indépendante. Même s’il a été régulièrement adapté aux évolutions éthiques et sociétales, il continue à illustrer la permanence des principes fondamentaux du soin - respect, bienveillance, professionnalisme et transmission - tout en reflétant les enjeux contemporains de la médecine.
[1] Battin J. Le serment d’Hippocrate et sa modernité. Bulletin de l'Académie nationale de médecine 2024;208(1):103-105. doi: 10.1016/j.banm.2023.11.008
[2] Chanques G. 1804-2024 : L’histoire intriquée des serments des docteurs dit d’Hippocrate en usage à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes et au Conseil de l’ordre des médecins. Lettre de l’ordre des médecins de l’Hérault 2024;38:16-26
[3] Le serment dit « d’Assaf », WKP Études bibliques
[4] Le serment dit « de Maïmonide », dans la notice Moïse Maïmonide, Wikipedia
[5] Chiffoleau S. Islam, science et médecine moderne en Égypte et dans le monde arabe. MOM Éditions 1995;125-38
[6] Déclaration de Genève, Association médicale mondiale, 1948
[7] Le serment d’Hippocrate. Ordre national des médecins, version de 2012 actualisée 2019
[8] Hégo D. Le serment d’Hippocrate d’hier à demain : état des lieux de l’utilisation du serment d’Hippocrate dans les 36 facultés de médecine françaises. Thèse de médecine, faculté de médecine Henri Warembourg, université Lille 2 Droit et Santé, 2016
[9] Serment d’Hippocrate, Santé Sorbonne Université
[10] Serment d’Hippocrate version historique, université de Strasbourg
[11] Serment d’Hippocrate, université de Franche-Comté

 9 minutes
9 minutes Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire






Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.